| Mont Saint-Michel Le livret de l'album |
Accueil + news
| ENGLISH PAGES Châteaux de la Loire | Mont Saint-Michel Brocéliande | Icônes | Revue de presse A Secret World | Destinations |
| Mont Saint-Michel Le livret de l'album |
Accueil + news
| ENGLISH PAGES Châteaux de la Loire | Mont Saint-Michel Brocéliande | Icônes | Revue de presse A Secret World | Destinations |
| Sur cette page, découvrez en détail le livret du CD Mont Saint-Michel. Textes © Nathalie Hureau - Gravures sur verre © Hervé Thibon |
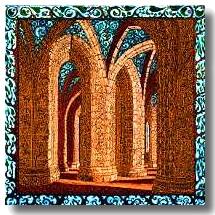 |
La
crypte des Gros Piliers
En ce temps là, la France et
l'Angleterre étaient en guerre. Au Mont Saint-Michel, l'abbé
était passé à l'ennemi, la ville était assiégée
et pour comble de malheur, en 1421, le choeur de l'église romane
s'était effondré. La reconstruction attendit la fin des hostilités.
Autre siècle, autre style, le gothique succéda au roman,
les lianes à la pureté de la ligne et l'alliance qui en jaillit
fut à l'épreuve du temps. Mais comment élever la pierre
à plus de 40 mètres de hauteur? On édifia, en 1446,
un soubassement de titan, la crypte des Gros Piliers, pour soutenir le
nouveau choeur de l'église. Dans cette forêt souterraine où
la lumière est recluse, les troncs de pierre ont des dimensions
de légende. Ils impressionnent par la puissance de leur assise qui
s'élève en une futaie magistrale. |
 |
Une
nuit dans l'abbaye
Les moines vont sous la lune froide.
Ils se déplacent sans hâte. Le gravier crisse sous leurs pas.
Durant ces heures sombres où les portes de l'église sont
fermées, ils récitent cette psalmodie : Vade Retro Satanas,
Numquam Suade Mihi Vana ; Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas. (Retire-toi
Satan, ne me conseille jamais ce qui est vanité ; il est mauvais
le breuvage que tu verses, bois toi-même tes poisons). On raconte
que l'église est interdite car c'est l'heure où les anges
chantent. Jusqu'à l'office des mâtines, les anges chantent
des louanges. Ils chantent des merveilles emplissant l'église d'une
lumière plus vive que le soleil. L'incandescence est telle que nul
être de chair ne peut s'y aventurer sans périr. |
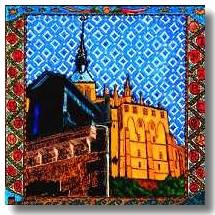 |
Thème
du pèlerin
Le pèlerin marche. Il part bannière
en tête, portant besace et calebasse. Surnommé Miquelet, il
suit les "chemins de Paradis" qui sillonnent la France et mènent
au Mont Saint-Michel. Au moyen âge, même les enfants font le
pèlerinage. Ils ont moins de douze ans, ils quittent père
et mère et se regroupent par milliers en cortèges spontanés.
Le pèlerin vient de tous pays. Il traverse villes et villages. Par
tout temps, par tout vent, il marche. Porté par la foi, il avance,
plein d'espoir. Chaque pas le rapproche de la mer. Et avant même
qu'il puisse discerner le murmure des flots, il découvre la haute
silhouette noire du Mont Saint-Michel qui s'élève tel un
mirage sur les herbus des pâturages. |
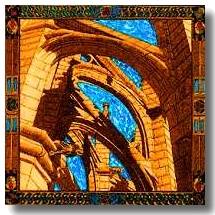 |
Gargouilles
et dentelle gothiques
Hors d'atteinte pour qui ne possède
pas d'ailes, la gargouille se penche vers le bas monde. De sa gueule s'écoulent
des sarcasmes. Bestiaire des hauteurs, un peuple d'êtres fantastiques
s'accroche à la flore minérale qui s'enracine dans la masse
puissante de la pierre. Lianes, fleurs et corolles recouvrent contreforts,
pinacles et arcs-boutants. Une dentelle de granit se dresse vers la lumière.
Élégance, harmonie, virtuosité. Le choeur de l'église,
fruit de la science profonde de l'architecture ogivale, fut élevé
au XVème siècle (1450-1521) sur les ruines du choeur roman
écroulé. L'ivresse du pur style gothique anime le chevet
d'une vie nouvelle. La pierre s'élance vers le ciel, suspendue,
aspirant à l'envol. |
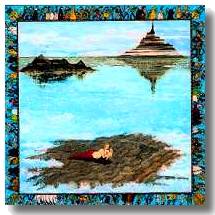 |
Sables
mouvants
Le lent trémolo des cordes annonce
le flux de la mer en mouvance. Accompagné par le chant du hautbois,
un groupe de pèlerins regagne la côte à travers les
grèves. Parmi eux, une femme, enceinte. Ils avancent sur le sable
dur et ridé des paumelles. Mais la mer est insidieuse. L'eau gagne,
l'eau lèche, l'eau monte. Les hommes pressent le pas. Ils abandonnent
la femme qui s'arrête, isolée au sein des tourbillons que
la mer soulève. C'est alors que l'épée de l'archange
arrête les flots. Saint Michel protège la femme qui enfante
dans le froid des sables et du vent. Quand le flux se retire, ils sont
vivants et l'enfant est baptisé Péril. Réalité
ou légende? On raconte que fut dressée à cet endroit
une croix qui donna son nom au miracle de l'accouchée de la Croix
des Grèves. |
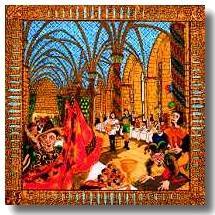 |
Un
festin dans la Salle des Hôtes
De véritables festins accueillaient
rois, reines et généreux donateurs dans cette salle richement
décorée de tapisseries, de vitraux et de carreaux vernissés.
Malgré son dépouillement actuel, la Salle des Hôtes
reste la plus élégante des six pièces qui composent
l'édifice de la Merveille, que vingt-cinq années (1203-1228)
suffirent à élever. Prouesse architecturale, la Merveille
se veut la représentation matérielle de l'ascension spirituelle.
Chiffres et symboles en rythment la composition. Trois, symbole de la Trinité.
Trois étages à flan de rocher. Equilibre virtuose de la pierre.
Sept, chiffre parfait. Sept voûtes par salle, symbole de totalité.
Sept, rythme inusité, choisi pour cette danse qui permet d'évoquer
la magie de ces festivités oubliées. |
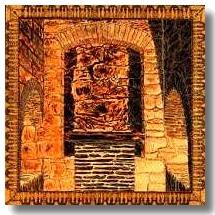 |
Dans
la crypte Notre-Dame-Sous-Terre
Cette église préromane,
bâtie sur les vestiges de l'oratoire primitif, est évoquée
par la simplicité du leitmotiv joué sur une guitare classique.
L'abbé Mainard et ses douze bénédictins s'y installèrent
en 966. Cette chapelle rectangulaire à la maçonnerie massive
de près de deux mètres d'épaisseur fut transformée
en crypte lors de la construction de l'église romane. De nos jours,
on y pénètre par un long escalier qui semble descendre au
coeur de l'univers. Longtemps oubliée et même obstruée,
Notre-Dame-Sous-Terre est une église enfouie dans la chaleur originelle
de la terre. Même au coeur de l'hiver cette chaleur suinte, tiède
et maternelle. Et c'est au plus profond de ce sanctuaire, derrière
le petit autel, que l'on aperçoit à découvert la roche
du Mont Tombe initial. |
 |
Immensi
Tremor Oceani
Le thème conducteur de l'album
est décliné non seulement par la basse de l'orgue, les arpèges
du synthétiseur, mais aussi par les voix qui reprennent la devise
des chevaliers de l'ordre de Saint-Michel : Immensi Tremor Oceani, la terreur
de l'immense océan... Cet ordre réservé à l'élite
chevaleresque fut institué en 1469 par Louis XI, fervent pèlerin
du Mont, pour concurrencer la célèbre Toison d'Or. Trente-six
chevaliers prêtèrent serment de garder, soutenir et défendre
la couronne royale. Revêtus d'un long manteau de damas blanc bordé
de fourrures d'hermine et de coquilles, ils arboraient un lourd collier
d'or à l'effigie de l'archange. Au Mont Saint-Michel, on rebaptisa
le scriptorium, pièce réservée aux travaux de copiste
des moines, du nom de Salle des Chevaliers bien que jamais l'Ordre n'y
siégea |
|
|