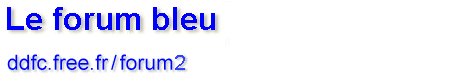| Retour à la liste des messages |
guydufau
07/06/2005
13:05 |
VIL LEPINADES |
Les "modèles" fantasmés de la bourgeoisie
6 juin 2005
Le taux de chômage est de 10 % en France, mais tourne autour de 5
% dans d’autres pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark ou Suède).
L’attachement au "modèle social français" et le
refus des "réformes" qui marchent ailleurs seraient la
source de tous nos déboires. Mais les faits sont têtus et
ne peuvent se réduire à cette lecture superficielle : il
suffit de regarder d’un peu plus près la réalité de
chacun de ces supposés "modèles".
Danemark
En 1993, le taux de chômage était de 9,5 % au Danemark et
de 11,6 % en France ; dix ans plus tard, il est descendu à 5,6 %
au Danemark et à 9,7 % en France (données OCDE). On
pourrait penser que le Danemark a créé plus d’emplois,
puisque le taux de chômage y a baissé plus vite. Or, c’est
faux. C’est en France que l’emploi a le plus augmenté sur cette
période : +10,7 % (2,4 millions d’emplois créés)
soit deux fois plus qu’au Danemark (5,5 %). La solution de cet apparent
mystère réside dans les dispositifs (préretraites,
stages de formation et autres années sabbatiques) qui ont permis
de faire sortir les personnes concernées de la population active,
et donc des statistiques du chômage danois. Les mérites
supposés de la "flexsécurité" danoise ne
sont donc pas vérifiés : ce deal, qui permet aux patrons
de licencier facilement en échange d’une protection sociale de
bon niveau pour les chômeurs, n’a pas permis de créer plus
d’emplois.
Royaume-Uni
Les comparaisons oublient toujours que ce pays a enregistré,
chaque année depuis dix ans, un taux de croissance
supérieur de 0,8 % à celui de la France. Avec un tel
supplément de croissance, le taux de chômage se situerait
aujourd’hui en France à 6 ou 7 %, au lieu de 10 %.
Deuxième oubli : une grande partie des créations d’emplois
au Royaume-Uni ont eu lieu dans les services publics, notamment la
santé, ce qui coïncide mal avec les options
libérales. Enfin, malgré sa croissance plus rapide, le
Royaume-Uni n’a pas créé plus d’emplois qu’en France tout
en faisant plus nettement reculer le taux de chômage. Là
encore, la différence provient de la population active : elle a
augmenté moins vite qu’en France sur les dix dernières
années (4,3 % contre 8,4 %), pour une progression voisine de la
population en âge de travailler. On enregistre ici l’effet des
politiques qui, en dissuadant les chômeurs de s’inscrire, permet
une baisse purement statistique du chômage.
Pays-Bas
L’emploi a progressé de 20 % entre 1993 et 2003. Mais les 2/3 des
emplois créés sont des emplois à temps partiel, qui
concernent principalement les femmes, puisque 60 % d’entre elles
occupent aujourd’hui un temps partiel, souvent très court. De
plus, le niveau du taux de chômage ne veut pas dire grand-chose
aux Pays-Bas, en raison du statut d’invalidité attribué
à des salariés souvent âgés et jugés
sans doute "inemployables". En février 2005, ils
étaient au nombre de 957 000 (12 % de la population active !) et
une bonne partie d’entre eux devraient être ajoutés aux 540
000 chômeurs recensés. Enfin, pas de chance, le
"modèle polder" est en crise et le taux de
chômage officiel vient d’atteindre 6 %.
Allemagne
Toute l’astuce est évidement de ne retenir que les pays qui vont
dans le sens de la démonstration. L’Allemagne est pourtant un
contre-modèle riche d’enseignements. Le camarade Schröder y
mène depuis plusieurs années un programme de
"réformes" en tout point conforme à l’orthodoxie
eurolibérale. Ses résultats sont désastreux, avec
près de 5 millions de chômeurs, soit 12 % de la population
active. De telles réformes ne peuvent relancer l’économie,
tout simplement parce qu’elles sont la cause du marasme. Le blocage des
salaires, sous prétexte de rétablir la
compétitivité, a permis (entre autres facteurs) une
progression spectaculaire des exportations (+ 6,6 % par an entre 1993 et
2003) mais a étouffé la demande intérieure (+ 1 %).
Le capitalisme rhénan est en train de sombrer dans la
régression et la précarisation : au cours des deux
dernières années, il a créé 500 000 emplois
mais détruit dans le même temps 853 000 emplois
réguliers.
Bricolages
Ces références à un modèle idéal sont
du pur bricolage idéologique : comment peut-on se réclamer
à la fois du modèle britannique et du modèle
nordique, alors qu’ils diffèrent sur des points essentiels ? Ces
âneries révèlent très vite
l’incohérence des libéraux, qui oublient évidemment
les contreparties pour eux inacceptables aux réussites
vantées avec enthousiasme. Par exemple, les dépenses pour
l’emploi rapportées au nombre de chômeurs
représentent environ 100 % du PIB par tête au Danemark, 150
% aux Pays-Bas, et 60 % en Suède. C’est beaucoup plus qu’en
France (38 %) et, bien sûr, qu’au Royaume-Uni (15 %). De la
même manière le taux de prélèvements
obligatoires est plus élevé en Suède (52 %), au
Danemark (50 %) qu’en France (45 %) alors que les libéraux
rêvent de le réduire.
Les économistes libéraux oublient en outre que c’est dans
les pays où la croissance a été la plus soutenue
que le taux de chômage a le plus baissé. Ils voudraient
faire croire que leurs fameuses "réformes structurelles des
marchés du travail" suffiraient à créer des
emplois indépendamment du taux de croissance. Il faudrait alors
démontrer que cette meilleure croissance est elle-même le
produit des politiques libérales, notamment en matière de
modération salariale. Pas de chance, car les choses fonctionnent
à l’inverse : les pays où les salaires ont
été le plus bloqués sont aussi ceux qui ont
enregistré une croissance moindre, et donc moins d’emploi.
Même au Royaume-Uni libéral, le pouvoir d’achat du salaire
a augmenté plus vite (2,1 % par an) que dans l’Union
européenne (+1,0 %) ou qu’en France (+0,3 %). Il en va de
même pour la Suède, où il a progressé de 2,2
% par an.
La stratégie européenne pour l’emploi proposait notamment
de "réduire la pression fiscale qui pèse sur le
travail, notamment sur le travail peu qualifié et faiblement
rémunéré" et d’ "améliorer les
effets d'incitation en faveur de l'emploi et de la formation des
régimes d'imposition et d'allocations". Ces recommandations
ont été suivies, mais il est clair aujourd’hui que cette
stratégie ne fonctionne pas. C’est ce que doit constater une
institution comme l’OCDE, qui rétribue pourtant des dizaines
d’économistes chargés d’illustrer les bienfaits du
libéralisme. Mais ceux-ci se heurtent régulièrement
aux faits, décidément têtus. Dans ses
dernières Perspectives de l’emploi, l’OCDE découvre ainsi
que la législation protectrice de l’emploi (LPE) … protège
l’emploi, et qu’elle remplit donc "l’objectif pour lequel elle a
été conçue". L’OCDE doit reconnaître
à contrecœur que son effet sur le chômage est
"ambigu" et que "les nombreuses évaluations
auxquelles cette question a donné lieu conduisent à des
résultats mitigés, parfois contradictoires et dont la
robustesse n’est pas toujours assurée". En langage clair,
cela veut dire qu’on ne peut pas mettre en lumière un effet
positif des fameuses "réformes structurelles des
marchés du travail" . En revanche, la précarisation,
à laquelle se ramènent au fond ces réformes, frappe
spécialement les jeunes et les femmes, qui "pourraient donc
être affectés de manière
disproportionnée", et l’OCDE va jusqu’à admettre que
la différence de traitement entre emplois permanents et
temporaires pourrait conduire à une accentuation de la
dualité du marché du travail".
Mais les politiques libérales ont-elles vraiment pour but de
créer des emplois ? Le cas de la Suède permet de montrer
que l’objectif réel est une flexibilisation sans fin. Ce pays a
d’ores et déjà atteint l’ensemble des objectifs de la
stratégie de Lisbonne, et il devrait donc avoir droit aux
félicitations de la Commission européenne ; or, celle-ci
persiste à lui recommander des mesures visant à
accroître les "incitations au travail", autrement dit
à se montrer moins généreuse à
l’égard des chômeurs.
Fuite en avant libérale
Et pourtant les "cent jours" du nouveau gouvernement vont
être consacrés à mettre en musique les rapports
ultra-libéraux (de Virville, Camdessus, Cahuc-Kramarz) que la
droite gardait sous le coude. Leur ligne générale est
l’attaque contre le droit du travail, autour de deux idées. La
première est celle d’un nouveau contrat de travail, fusionnant
par le bas CDI et CDD. Le rapport de Virville parle de contrat de
mission "autour de projets, à l’horizon de quelques mois ou
quelques années" : l’objectif est clairement de
précariser l’ensemble des contrats. La seconde idée est
l’institution d’une "taxe sur les licenciements"
(Cahuc-Kramarz) : en échange d’une contribution symbolique (moins
coûteuse que les cotisations chômage, sinon où est
l’intérêt ?), les patrons seraient
débarrassés de toutes les "rigidités" du
code du travail en matière de licenciements Avec un incroyable
cynisme, De Virville évoque la cessation du contrat de travail
"pour rupture négociée" : on imagine la
"négociation" ! Camdessus propose en outre de
réduire les cotisations sociales des PME, et Cahuc-Kramarz de
libérer les professions "protégées"
Christine Lagarde, la nouvelle ministre au commerce extérieur,
vient de déclarer sur Europe 1 (le 4 juin) que le droit du
travail constituait un "frein à l'embauche". Borloo a
annoncé au Journal du Dimanche du 5 juin qu’il étudiait un
nouveau contrat de travail "expérimental simplifié et
très allégé en charges" pour faciliter
l'embauche dans les "très petites entreprises". On voit
que les références aux modèles étrangers ne
visent au fond qu’à légitimer une nouvelle vague de
régression sociale. Derrière les argumentaires
bricolés et le discours sur le "déclin", pointe
la frénésie de classe qui s’est emparée d’un
gouvernement aux abois. Il n’a aujourd’hui d’autre "plan B"
que la fuite en avant : après les cent jours, Waterloo ?
Michel Husson
Face à cette analyse,quelles vilepinades allons-nous entendre,
demain, mercredi ?
|
paul
07/06/2005
15:45 |
re : VIL LEPINADES |
Merci Guy, beau boulot.
|
Univac Bros
07/06/2005
15:49 |
rectifions |
Merci Michel Husson, belle rédaction.
Bravo Univac, le cop-coll fonctionne à merveille.
Pas de félicitations pour Guy : manque la source de ce texte.
L'auteur ne suffit pas.
|
audreymalran
07/06/2005
19:12 |
SOURCES |
http://hussonet.free.fr/rougemod.pdf
|
Azincourt
07/06/2005
21:14 |
re : VIL LEPINADES |
je l'avais predit, il n'a pas osé la vile pine mais notre
predicateur se laisse aller a ce genre de consideration, la machine a
aligner les mots est en marche, a noter l'odeur fetide de la brandade
qui emane du discours frelaté.
une Vile pinade?
oh oh oh nous nous amusons, follement cher ami!
quel humour, quel finesse et de surcroit quelle belle ecriture, quel
style mes amis, levons donc nos verres de clairette pour feter cette
élocution, que feu Amyot n'aurais su ecrire.
A ae propos est il donc vrai que ce ministre fut si bien membré,
qu'il est fort apprecié de ces dames.
allez ce que tu n'ecris pas Henri Des l'ecrira pour toi
|
guydufau
08/06/2005
12:41 |
re : VIL LEPINADES |
Sans avoir tout saisi des propos d'Azincourt, villepinades est à
rapprocher de raffarinades et cela apparaitra de plus en plus
cohérent, ces deux premiers ministres étant l'un comme
l'autre de sacrés baratineurs.
|
guydufau
13/06/2005
10:05 |
re : VIL LEPINADES |
LE « FREIN A L'EMBAUCHE », C'EST LE LIBERALISME
Thomas Coutrot, Jean-Marie Harribey, Michel Husson
(économistes)
Le 29 mai les Français ont clairement rejeté les
politiques libérales porteuses de chômage et
d'insécurité sociale. Pourtant, sans surprise, Dominique
De Villepin vient de proposer un train de mesures qui aggravent ces
politiques. L'idée de base : les « rigidités »
et le code du travail seraient un frein à l'embauche. Le contrat
« nouvelle embauche », réservé pour l'instant
aux petites entreprises, réduit de façon inédite
les garanties des salariés et accroît
l'insécurité. De nouvelles exonérations sont
accordées, cette fois pour alléger le « fardeau
» des entreprises qui dépassent 10 salariés. La
pression sur les chômeurs pour qu'ils acceptent n'importe quel
emploi est renforcée.
Mais même l'OCDE le reconnaît : la démonstration n'a
jamais été faite que la flexibilité du
marché du travail réduisait le chômage. Au «
modèle danois », de Villepin emprunte la flexibilité
mais pas l'assurance chômage de haut niveau. En France on sait
pourtant ce qui marche pour créer des emplois. Le « ticket
gagnant » - croissance utile et réduction du temps de
travail - avait commencé à fonctionner entre 1997 et 2001
(2 millions d'emplois créés), avant d'être
relativisé par Jospin et abandonné par Raffarin. Il faut
en premier lieu renouer avec une croissance fondée sur la
satisfaction des besoins sociaux, et donc sur la création
d'emplois socialement utiles. Santé, éducation, aide aux
personnes âgées, logement, économies
d'énergie, transports collectifs. Nombreux sont les secteurs dont
la « croissance utile » et non productiviste serait
très créatrice d'emplois.
Comment financer cette nouvelle croissance utile ? D'abord par la
relance de la consommation des couches les plus démunies. Alors
que la santé financière des grands groupes est insolente
au point qu'ils ne savent plus quoi faire de leurs liquidités,
une forte revalorisation du SMIC, des salaires et des minimas sociaux
s'impose. Il faut aussi relancer la consommation collective de services
publics, par des programmes d'investissement massif dans les secteurs
évoqués ci-dessus.
Il faut en second lieu accorder la priorité à la
réduction du temps de travail, en commençant par
l'étendre à l'ensemble des lieux de travail, qu'il
s'agisse des petites entreprises ou du secteur public, puis en
avançant vers les 32 heures. Il faudra bien sûr
éviter les travers des lois Aubry : empêcher une nouvelle
intensification du travail, favoriser des embauches proportionnelles
à la RTT et réduire la précarité, notamment
en ce qui concerne le temps partiel imposé aux femmes. Pour
conduire le mouvement, il faudra un double contrôle venant
à la fois d'en haut (la réglementation, notamment sur les
heures supplémentaires) et d'en bas (l'intervention des
salariés). Le caractère automatique des aides devra
être supprimé et leur versement soumis au respect d'un
certain nombre de critères portant sur les créations
d'emplois et sur la qualité de ces emplois, sous contrôle
des comités d'entreprise ou des organisations syndicales.
Il faut enfin s'attaquer réellement à la
précarité au lieu de la renforcer sans cesse au nom de
l'emploi. A la flexibilité généralisée, il
faut opposer une véritable sécurité sociale
professionnelle qui vise d'une part, à réunifier les
contrats de travail aujourd'hui complètement
éclatés, d'autre part à instaurer une
continuité des droits sociaux, notamment en matière de
rémunération. Défini au niveau national, pour
éviter les surenchères vers le bas, ce système
devrait s'accompagner de la mise en place de réseaux (locaux et
au niveau des branches) incitant les entreprises à
coopérer avec des organismes de formation ou les
collectivités locales afin de préserver l'emploi à
la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif.
Simultanément il importe de développer le droit de la
« co-activité », ouvrant aux salariés des
entreprises sous-traitantes les garanties statutaires (salaire, temps de
travail, représentation syndicale, etc.) de leur donneur d'ordres
et réduisant ainsi la propension de ces derniers à
utiliser la sous-traitance pour contourner les règles de
protection de la main-d'¦uvre.
Comment financer tout cela ? Les moyens existent : en prenant sur les
dividendes des actionnaires et les rémunérations des
dirigeants, en remettant en cause les exonérations
inconditionnelles de cotisations, en taxant les revenus financiers, on
dégage largement les 4 à 5 points de PIB
nécessaires pour financer ces projets. La croissance
retrouvée donne des marges de manoeuvre supplémentaires et
permet même de réduire les déficits. On avance ainsi
vers une société du temps libre, plus juste et solidaire,
qui se débarrasse progressivement du chômage.
Le hic, c'est que tout cela suppose évidemment de modifier la
répartition des revenus entre travail et capital. La
montée du chômage a permis de faire reculer les salaires et
progresser les revenus financiers, alors que l'investissement productif
a stagné. Vouloir inverser la courbe du chômage sans
toucher à la répartition des revenus est illusoire. Il
faut prendre le problème par les deux bouts : d'un
côté, financer l'augmentation des budgets sociaux par une
refiscalisation des revenus du capital et par une progression du taux de
cotisations sociales en phase avec les dépenses à financer
; de l'autre, permettre aux salaires d'augmenter en phase avec la
production de richesses.
L'objection est évidente : la compétitivité serait
mise à mal et on finirait par détruire des emplois au lieu
d'en créer. Mais il ne faut pas confondre
compétitivité et rentabilité financière : la
politique proposée suppose un transfert des revenus financiers
vers les budgets sociaux et les salaires, pas une perte de
compétitivité. Les entreprises peuvent verser plus de
salaires mais moins de dividendes, de façon à maintenir
leur compétitivité-prix et leur capacité
d'investissement.
Toutefois, il faut convenir qu'une telle politique ne prend tout son
sens que coordonnée à l'échelle européenne.
Le discours sur les « modèles » irlandais ou danois
ne doit pas faire oublier que l'Union européenne recense
aujourd'hui 20 millions de chômeurs, auxquels il faut ajouter la
cohorte innombrable des « invalides », des
pré-retraités, des « stagiaires » et des
femmes contraintes au temps partiel. L'échec de la
stratégie européenne pour l'emploi est patent, si tant est
que son objectif était bien l'emploi et non la
flexibilité. L'Allemagne, avec ses 5 millions de chômeurs,
l'illustre bien.
Il faut donc renverser les priorités, de manière à
faire passer l'emploi avant l'orthodoxie financière et
monétaire. A l'échelle européenne, deux conditions
sont impératives : la remise en cause de l'indépendance de
la Banque centrale et celle du Pacte de stabilité. Et deux axes
spécifiquement européens doivent être mis en avant :
il faut d'abord une augmentation très importante du budget de
l'Union pour financer un plan de relance (transports ferroviaires,
logement, économies d'énergie, etc.) à l'aide
d'impôt européen sur le capital ou de taxes de type Tobin,
et/ou par l'emprunt. D'autre part, pour avancer vers la mise en place
d'une véritable Europe sociale, il faut édicter des normes
dont la réalisation serait assurée par l'extension des
fonds structurels, de manière à enclencher un processus de
convergence « par le haut » qui permettrait le rattrapage
des pays les moins développés. Plus
généralement, il faut viser à des politiques
coordonnées en matière de salaires (un régime de
hausses de salaires au moins égales aux gains de
productivité), de durée du travail (réduire la
durée du travail dans tous les pays, de façon
différenciée selon les besoins en matière de
créations d'emplois), de protection sociale (assurer le
nécessaire financement des retraites par répartition
grâce à un ajustement permanent des cotisations ou
prélèvements), de sécurité au travail et de
conditions de travail. Si l'Union européenne commençait
à réorienter ses politiques dans ce sens, il ne fait
guère de doute qu'elle redeviendrait alors rapidement attractive
pour tous ses peuples.
Le contenu de cet article est à rapprocher de ce qui est
écrit sur le fil" Fléxibilité et stock
zéro". Si ce programme politique était
appliqué, nul doûte que le baron Sellières ferait un
appel "aux armes actionnaires".
|
Henry Faÿ
13/06/2005
10:36 |
smiley27 |

Ça te fatiguerait trop de dire ce que tu as à dire, y
compris en faisant des citations et de ne pas encombrer le forum avec
des cop'coll indigestes?


|
Nazdeb
13/06/2005
11:46 |
re : VIL LEPINADES |
D'accord avec Henry. Il faudrait avoir l'habitude d'écrire un
résumé ou une synthèse, voire une reprise des
idées essentielles, des textes qu'on copie-colle. Ce serait une
façon de mieux respecter les autres contributeurs et de montrer
une implication sincère dans les échanges.

|
guydufau
13/06/2005
12:17 |
re : VIL LEPINADES |
Salut Nazdeb, as-tu fait un bon voyage ?
Concernant cet article,je me suis senti incapable d'en faire un
résumé. Est-il indigeste ? Pour Henry, sûrement et
bigrement.
|
guydufau
15/06/2005
13:59 |
re : VIL LEPINADES |
Les villepinades, ont-elles autant de souffle et dureront-elles aussi
logtemps que les prophéties de Victor Hugo ?
L’Europe de Victor Hugo
Au XIXe siècle peu d’écrivains ont parlé de
l’Europe avec autant d’émotion et d’intelligence que Victor Hugo.
Aucun n’a eu ses fulgurances, ses prémonitions. Le jeune Victor
s’en prend d’abord à l’Europe des rois, celle que la
Révolution et l’Empire ont combattue, qui va du Rhin à
l’Oural. L’Europe de la Contre-Révolution.
Victor Hugo donne sa vista la plus accomplie de l’Europe dans la
préface au Paris guide de l’Exposition de 1867.
Au vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire.
Cette nation sera grande, ce qui ne l’empêchera pas d’être
libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste
de l’humanité. Elle aura la gravité douce d’un
aînée. Elle s’étonnera de la gloire des projectiles
coniques, et elle aura quelque peine à faire la différence
entre un général d’armée et un boucher ; la pourpre
de l’un ne lui semblera pas très distincte du rouge de l’autre.
Une bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais et Russes, entre
Prussiens et Français, lui apparaîtra comme nous
apparaît une bataille entre Picards et Bourguignons. Elle
considèrera le gaspillage du sang humain comme inutile. Elle
n’éprouvera que médiocrement l’admiration d’un gros
chiffre d’hommes tués. Le haussement d’épaules que nous
avons devant l’Inquisition, elle l’aura devant la guerre. Elle regardera
le champ de bataille de Sadowa de l’air dont nous regardons le quemedaro
de Séville. Elle trouvera bête cette oscillation de la
victoire aboutissant invariablement à de funestes remise en
équilibre et Austerlitz toujours soldé par Waterloo…
[…]
Un peuple fouillant les flancs de la nuit et préférant, au
profit du genre humain, une immense extraction de clarté.
Voilà quelle sera cette Nation. Cette Nation aura pour capitale
Paris et ne s’appellera point la France ; elle s’appellera l’Europe.
Elle s’appellera l’Europe au vingtième siècle, et aux
siècles suivants, plus transfigurée encore elle
s’appellera l’Humanité.
L’Humanité, nation définitive, est dès à
présent entrevue par les penseurs, ces contemplateurs des
pénombres, ce à quoi assiste le dix-neuvième
siècle, c’est à la formation de l’Europe. Vision
majestueuse !…
|
| Retour à la liste des messages |