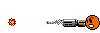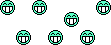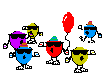| Retour à la liste des messages |
doc justice
12/10/2007
22:49 |
Comment privatiser les services publics |
Sur ce forum j'ai des fans liberaux un peu grossiers. Il ne faut pas les
decevoir. Voici donc un extrait du mode d'emploi pour xxxxxxx les
peuples
J'aime bien cette perle :
"on peut supprimer des primes dans certaines administrations, en
suivant une politique discriminatoire pour éviter un front commun
de tous les fonctionnaires. Évidemment, il est
déconseillé de supprimer les primes versées aux
forces de l’ordre dans une conjoncture politique difficile où
l’on peut en avoir besoin."
OCDE - CAHIER DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE N° 13
La Faisabilité politique de l'ajustement (1996)
extrait p29, 33 & 34
« La réduction des salaires et de l’emploi dans
l’administration et dans les entreprises parapubliques figure,
habituellement, parmi les principales mesures des programmes de
stabilisation. En principe, elle est moins dangereuse politiquement que
la hausse des prix à la consommation : elle suscite des
grèves plutôt que des manifestations et elle touche les
classes moyennes plutôt que les pauvres (il y a peu de
fonctionnaires parmi les 40 pour cent les plus pauvres). Mais ce n’est
pas parce que cette mesure peut se justifier du point de vue de
l’équité qu’elle ne comporte pas de risque politique. En
effet, il s’agit de secteurs où la proportion de salariés
syndiqués est la plus élevée, où les
salariés ne prennent pas de risque en faisant grève comme
dans le secteur privé et, enfin, où la grève peut
être une arme très efficace : l’économie est
paralysée par une grève des transports ou de la production
d’électricité ; et l’État est privé de
recettes si les agents du fisc cessent de travailler. La grève
des enseignants n’est pas, en tant que telle, une gêne pour le
gouvernement mais elle est indirectement dangereuse, comme on l’a
noté, puisqu’elle libère la jeunesse pour manifester. Ces
grèves peuvent donc devenir des épreuves de force
difficiles à gérer. Certes, le gouvernement peut toujours
rétablir le calme en annulant les mesures qui ont
déclenché la grève mais, ce faisant, il renonce
à réduire le déficit budgétaire. Le
gouvernement a toutefois les moyens de faire appel au pragmatisme des
fonctionnaires. Il peut, par exemple, expliquer que, le FMI imposant une
baisse de 20 pour cent de la masse salariale, le seul choix possible est
de licencier ou de réduire les salaires et qu’il
préfère la seconde solution dans l’intérêt de
tous. Les expériences de plusieurs gouvernements africains
montrent que ce discours peut être entendu.
La Faisabilité politique de l'ajustement
Si les analyses sur de larges échantillons ont montré une
relation entre ces mesures d’austérité et les
grèves, les études de cas nous ont aussi montré
qu’il existe une marge de manoeuvre pour un gouvernement, qui a
été exploitée avec succès dans certains pays
comme le Maroc ou la Côte d’Ivoire. Les salaires nominaux peuvent
être bloqués (ce qui allège rapidement la masse
salariale en termes réels si le taux d’inflation atteint 7 ou 8
pour cent) ; on peut ne pas remplacer une partie des salariés qui
partent en retraite ; ou bien l'on peut supprimer des primes dans
certaines administrations, en suivant une politique discriminatoire pour
éviter un front commun de tous les fonctionnaires.
Évidemment, il est déconseillé de supprimer les
primes versées aux forces de l’ordre dans une conjoncture
politique difficile où l’on peut en avoir besoin. Comme on le
voit, pourvu qu’il fasse des concessions stratégiques, un
gouvernement peut, en procédant de manière graduelle et
par mesures sectorielles (et non globales), réduire les charges
salariales de manière considérable. L’essentiel est
d’éviter un mouvement de grève générale dans
le secteur public qui remettrait en question un objectif essentiel du
programme de stabilisation : la réduction du déficit
budgétaire. »
« Mais la réforme la plus souvent nécessaire, et la
plus dangereuse, est celle des entreprises publiques, qu’il s’agisse de
les réorganiser ou de les privatiser. Cette réforme est
très difficile parce que les salariés de ce secteur sont
souvent bien organisés et contrôlent des domaines
stratégiques. Ils vont se battre avec tous les moyens possibles
pour défendre leurs avantages, sans que le gouvernement soit
soutenu par l’opinion parce que les bénéfices de la
réforme n’apparaîtront qu’après plusieurs
années et seront diffus, tandis que les perdants seront
touchés immédiatement. Plus un pays a
développé un large secteur parapublic, plus cette
réforme sera difficile à mettre en oeuvre, le cas limite
étant celui des économies socialistes où les
dangers sont les plus grands.
Quelques précautions sont souhaitables. Cette réforme ne
devrait tout d’abord pas coïncider avec un programme de
stabilisation, car la coalition des opposants serait très
dangereuse, avec la conjonction de manifestations de masse et de
grèves dans des secteurs clés. Ensuite, il ne faut pas
acculer ces salariés au désespoir en les licenciant
purement et simplement. Des fonds de reconversion sont indispensables
pour les réinsérer. Enfin, il est souhaitable, dans un
premier temps, d'exclure de la réforme les secteurs
stratégiques comme l’énergie ou les transports, quitte
à prendre des mesures plus tard, dans une conjoncture politique
et économique meilleure.
Il est permis toutefois de nuancer cette estimation des risques : par
rapport aux pays développés, les gouvernements des pays en
développement ont plus de facilités pour intervenir. Par
exemple, il leur est plus facile de faire dissoudre des piquets de
grève ou de remplacer les grévistes par d’autres
salariés. Il leur est aussi plus facile de réduire le
poids de ces entreprises, par exemple en diminuant le financement des
investissements ou en introduisant des concurrents privés lorsque
l’activité le permet. L’expérience de certains pays
où des opérations de rationalisation ou de privatisation
ont pu être menées à bien (Bouin et Michalet, 1991),
montre que les marges de manoeuvre d’un gouvernement peuvent être
plus grandes dans les PED que dans les pays développés.
Dans ces conditions, on peut parfois envisager la réforme de
secteurs stratégiques dès le début, ce qui est
souhaitable, en raison de l’incidence de cette réforme sur le
reste de l’économie.
Comment adapter la constitution à l’ajustement
On raisonne habituellement sur la faisabilité politique de
l’ajustement, toutes choses égales par ailleurs, en prenant le
cadre institutionnel comme une donnée exogène. Or, il est
tout à fait démocratique de changer ce cadre avec l’accord
de la population. L’expérience montre en effet que certaines
dispositions constitutionnelles sont un véritable obstacle
à l’ajustement. C’est le cas par exemple de l’Équateur,
où la brièveté des mandats et l’absence de
coalition parlementaire stable à cause du scrutin proportionnel
ont empêché les présidents qui se sont
succédé pendant les années 80 de mener à
bien des programmes de stabilisation indispensables. Par ailleurs, deux
études (Roubini et Sachs, 1989 ; et Grilli, Masciandaro et
Tabellini, 1991) ont montré que les pays où le parlement
était élu par un système à vote majoritaire
maîtrisaient mieux leur dette que ceux où il était
élu à la proportionnelle.
Des réformes, comme celles sur la longueur des mandats, le mode
de soutien, le référendum ou le droit de grève,
peuvent faciliter l’ajustement. La longueur des mandats est une variable
importante, parce que l’ajustement est caractérisé par des
effets négatifs à court terme et positifs à moyen
ou long terme. Si les mandats du parlement ou de l’exécutif sont
trop courts, l’application de programmes de stabilisation sera rendue
très difficile, puisque l’échéance
électorale arrivera avant l’heure des bénéfices de
l’ajustement. Il importe donc que les mandats durent au moins cinq ans,
étant entendu que le nouveau gouvernement utilise les premiers
mois — la période où la résistance au statu quo est
la plus faible — pour prendre les mesures impopulaires. De plus, il faut
veiller au regroupement des élections, afin de ne pas transformer
une série de scrutins en une suite de référendums
sur l’ajustement.
Pour qu’un gouvernement ait la marge de manoeuvre nécessaire pour
ajuster, il doit être soutenu par un ou deux grands partis
majoritaires et non par une coalition de petits partis, ce qui conduit
à préférer le scrutin uninominal au scrutin
proportionnel pour l’élection du parlement (ou pour le moins
à conseiller une combinaison des deux modes de scrutin). D’autres
moyens permettent de renforcer l’exécutif, comme la
possibilité de pouvoirs spéciaux temporaires ou un
contrôle ex post par le pouvoir judiciaire, afin d’éviter
que des juges puissent bloquer ex ante l’application du programme. Le
référendum peut être une arme efficace pour un
gouvernement dès lors qu’il en a seul l’initiative. En effet, les
groupes d’intérêt qui s’opposent à des mesures
d’ajustement défendent souvent des intérêts
particuliers et minoritaires sous le voile de l’intérêt
général. Le recours au référendum pour faire
approuver une mesure précise permet au gouvernement d’expliquer
sa politique et de disloquer une coalition d’opposants.»
|
.
12/10/2007
22:51 |
re : Comment privatiser les services publics |
auriez vous l'obligeance de renvoyer à la source internet svp
|
.
12/10/2007
23:08 |
re : Comment privatiser les services publics |
http://leruisseau.iguane.org/IMG/OCDEcahierpolitique13.pdf
<< LES IDÉES EXPRIMÉES ET LES ARGUMENTS
AVANCÉS DANS
CETTE PUBLICATION SONT CEUX DES AUTEURS ET NE
REFLÈTENT PAS NÉCESSAIREMENT CEUX DE L'OCDE OU DES
GOUVERNEMENTS DE SES PAYS MEMBRES. >>
Ceci jette une sérieuse ombre sur la crédibilité
militante qui prétend voir dans ce cynisme un peu primaire la
preuve de la ligne mise en oeuvre par l'OCDE.
|
..
12/10/2007
23:09 |
re : Comment privatiser les services publics |
l'attachement pathologique au service public doit être
considéré comme un syndrôme infantile, rien de plus,
rien de moins
|
dom
12/10/2007
23:17 |
puf! |
Le référendum peut être une arme efficace pour un
gouvernement dès lors qu’il en a seul l’initiative. En effet, les
groupes d’intérêt qui s’opposent à des mesures
d’ajustement défendent souvent des intérêts
particuliers et minoritaires sous le voile de l’intérêt
général.
voila une vérité!
|
doc justice
12/10/2007
23:26 |
re : Comment privatiser les services publics |
Voilà le doc original : http://www.oecd.org/dataoecd/24/23/1919068.pdf
D'ailleurs ce cahier a tellement choqué dans certains milieux
(les visiteurs de ce forum apprecieront de savoir qu'on le trouve
cité par "Reconstruire l'école" et "Sauver
les lettres") que l'ocde a du se fendre d'un communiqué. De
toute façon ces idées en circulation reflètent un
état d'esprit et elles n'ont pas été perdues pour
tout le monde.
C'est ainsi que des methodes a priori conçues pour tuer un
secteur public déficitaire ont été
appliquées à des secteurs publics largement beneficiaires
comme les assurances, le monopole d'edf ou le monopole postal, sans
parler de l'education qui n'a pas vocation à être rentable
d'un point de vue ethique
|
Doc Korzybski
12/10/2007
23:35 |
le jeu du diagnostic |
Ce qui est génant dans ce débat permanent sur/autour des
services publics :
- les uns semblent littéralement obsédés par le
scénario d'une "casse" ou d'une
"destruction", à l'issue de laquelle apparemment la vie
ne mériterait plus d'être vécue, à moins que
ce ne soit la société qui ne mérite plus
d'être vivable, ou mieux (pire), la démocratie qui y
perdrait à la fois son nom, son âme, sa raison d'être
etc
Cette première position peut être résumée
"Hors du service public point de vie digne d'être
vécue".
- en face on trouve les autres, ceux qui ne considèrent pas le
service public comme l'outil indispensable, universel, inamovible (bref
: l'outil-miracle) de l'organisation sociale ; ils ont l'imprudence de
le dire, et parfois ils le martèlent, probablement pour le
plaisir d'escagasser les précédents. Ca n'est pas
très malin de leur part. De même que ça n'est pas
très malin de la part des premiers, de débarquer un peu
partout avec leur catéchisme et leur vérité
définitive, essentielle, détenue par eux et par eux seuls.
De mon point de vue, l'aberration sémantique est plutôt du
côté des premiers qui, dans leur propos, manient d'ailleurs
assez fréquemment l'implicite, ce qui est signe d'un niveau de
conscience assez faible, mais passons. En assimilant
systématiquement le service public à la seule organisation
sociale acceptable, ils ne répondent jamais à la question
que leur posent leurs adversaires : que faire quand ledit service public
arrive au bout de son efficacité ? Que faire quand le service
public devient impossible à financer ?
En outre les partisans de l'assistanant social confondent la fin avec
les moyens : pour eux le Service Public tel qu'ils le connaissent est
devenu une fin en soi, la seule façon acceptable de vivre en
société. Parallèlement, ils croient constater
("diagnostiquer") chez leurs adversaires une volonté
d'éradiquer le Service Public, alors que la réduction (et
la suppression plausible) dont il s'agit, n'est pas celle du service
public dans son ensemble, mais de certains organes du secteur public,
ceci pour maintenir le service, en en confiant la fourniture à
d'autres formes d'organisation. Outre la conception évidemment
fixiste que les premiers se font de la société (ce qui a
été mis en place ne doit pas être supprimé,
quand bien même cela serait devenu inefficace, contre-productif,
ruineux, truffé d'effets pervers) il est permis de
s'inquiéter soit pour eux, du fait de leur aveuglement social,
soit pour la société qui avec eux abrite ce en quoi on est
en droit de "diagnostiquer" des enclaves corporatistes.
Doc Korz.
|
korz
12/10/2007
23:37 |
un peu de concret svp |
Réponse à 23h26 :
Il faudrait démontrer par le menu qu'il y a un lien entre ces
textes et ce qui a été objectivement fait.
Faute de quoi, on reste dans le procès un peu creux, où
les uns martèlent les évidences que leur suggèrent
leurs conviction, mais où dans les faits, on ne voit pas grand
chose de bien probant.
Korz
|
I love smileys
12/10/2007
23:43 |
you know you do too |
                                      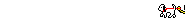          smiley smiley                    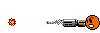      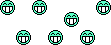         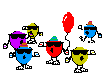        
|
What do you mean
12/10/2007
23:45 |
re : Comment privatiser les services publics |
Ce texte extirpé de l'OCDE par des militants avec la
prétention d'y lire l'alpha et l'oméga de ce qui les fait
enrager, ce texte tout comme l'agumentation qui y est attachée,
est une baudruche. Ayant trouvé un texte qui leur semble
crapuleux et qu'en effet on peut lire comme un exercice de management
cynique, nos amis prétendent qu'il est en lien direct avec la
réduction du secteur public. Sauf que ce lien est tout sauf
démontré. Le problème c'est que, quand on est
armé de convictions forcenées, on croit diagnostiquer
quand on interpète, et on croit démontrer quand on
vaticine.
Nos amis feraient mieux de se pencher sur le comportement des
fonctionnaires, où ils trouveraient bien plus aisément,
par les abus divers de pouvoirs, de prébendes, de
privilèges, les véritables causes de la disgrace dans
laquelle nous avons vu tomber le service public de notre beau pays.
|
gag
13/10/2007
00:08 |
re : Comment privatiser les services publics |
marrant comme ces salauds de fonctionnaires savaient fournir un tarif
postal ou de l'energie moins chere que n'importe quelle boite
privée avec en plus des bureaux de proximité dans le
moindre patelin.
|
gog
13/10/2007
00:19 |
re : Comment privatiser les services publics |
sauf erreur ceux-là ne sont point ici incriminés comme
étant des salauds, cela dit ils ne sont pas non plus
créitables d'etre les concepteurs de ce formidable système
dont ils ne sont que les agents, il eut mieux valu écrire
"... le comportement de certains fonctionnaires" tant il est
vrai qu'une minorité agissant dans le mauvais sens est capable de
détruire une organisation qui s'avérait excellente et
performante non non voyons ceux qui ont pourri l'ensemble ce sont bien
sur les délégués du personnel où avais-je la
tête
|
Pierre
15/10/2007
08:01 |
re : Comment privatiser les services publics |
En général, ceux qui défendent les services publics
ont non seulement une position éthique (mutualiser la
santé et l'éducation), une position politique (garder son
independance energetique, créer une société
apaisée et non une société de guerre de tous contre
tous), mais aussi une vision pragmatique. En effet, ils ont fait
l'experience de services publics qui fonctionnaient bien mieux que les
boites privées. A titre personnel, j'ai connu une epoque
où le courrier était plus rapide qu'aujourd'hui ;
où le facteur passait 3 fois par jour ; où le facteur
était un être humain avec qui on pouvait discuter ;
où les colis n'étaient pas perdus par des filiales opaques
de la poste ; où on pouvait poster sa lettre dans le train du
soir où dans un bureau de poste de proximité... (10.000
bureaux ont été fermés au nom de la concurrence).
Le principe appliqué par le service public postal
auto-financé était de financer les bureaux de poste
deficitaires de village par les bureaux de poste de grandes villes. Le
principe actuel de supprimer tout ce qui est deficitaire est un principe
à la con qui nous oblige à vivre comme des bêtes
|
comme des betes
15/10/2007
14:07 |
re : Comment privatiser les services publics |
Mais si cette époque appartient au passé, mieux vaudrait
replacer le phénomène dans le temps et donc dans son
histoire propre. Toute organisation sociale peut régresser, pour
des raisons internes (le fonctionnariat pourrait être un germe de
régression) ou externes (le secteur public tenaitt surtout par
des apports extérieurs, que la société n'est
peut-être plus capable de fournir).
Quand à la société de "guerre de tous contre
tous", elle s'alimente fort bien aux corporatismes fort actifs que
mettent en oeuvre les privilégiés, visant leur
intérêt tout en affichant (et probablement en s'imaginant)
qu'ils défendent celui de tous.
Notez qu'ici je tente de proposer des explicaitons techniques, pendant
le bref espace de temps qui sépare votre post apparemment
technique, et le moment où vous allez sortir la banderole de
clichés, puisque vous reconnaissez être obligé de
penser comme une bête.
|
?
15/10/2007
16:08 |
re : Comment privatiser les services publics |
<< 10.000 bureaux ont été fermés au nom de la
concurrence >>
Il serait plus exact d'invoquer la raison budgétaire.
Justifiée ou non, c'est d'ailleurs le problème.
Mais pourquoi confondre la concurrence avec les principes
élémentaires de la gestion, fut-ce celle d'un monopole ?
|
rascal
15/10/2007
19:06 |
l'amui ricoré |
créer une société apaisée et non une
société de guerre de tous contre tous
c'est pour cela qu'on a créer des regimes speciaux, de maniere a
créer une République de nanti face a des cons de
travailleurs, trop cons pour ne pas bénéficier des
services spéciaux, la gestion de la camif est l'exemple
même de la réussite du systeme, quant a la visite de l'ami
déchiré on s'en fout de la proximité, si toi tu as
du temps a perdre grand bien te fasses, mais de savoir que la balance se
balade pas loin de chez toi pour savoir si a l'epoque tu payais la
redevance, ce n'était pas forcement apprecié de tout le
monde, mais encore plus réaliste le cout, pour les entreprises
des greves a répétitions du secteur public a
été tel que certains ont été obligé
de créer leurs services de courrier ne serait ce que pour que la
facturation circule, la mémoire courte Pierre, trop courte....
la poste ne defend que son interet, pour preuve elle vend des produits
financiers merdiques que n'importe quel bureau de tabac pourrait vendre,
la poste ne peut pas arriver a avoir la compétance d'une banque,
il suffit d'avoir 4 ronds sur un compte pour que le village soit au
courant.
mais encore comment se fait il que les fonctionnaires partent a 60 ans
en retraite, probablement parce qu'il sont aussi cons que les
travailleurs du privé, il est toujours amusant de lire la
confusion des droits régaliens déformés par la
militance
|
casse-croûte
15/10/2007
19:24 |
re : Comment privatiser les services publics |
Produits tout aussi merdiques que ceux proposés par d'autres
banques, et parfois en commun avec elles (cf les produits dont le
fonctionnement est géré par la CNP).
Le village peut aussi être au courant des 4 sous que tu places au
crédit agricole du coin.
|
Tristan
15/10/2007
22:59 |
re : Comment privatiser les services publics |
En tant que particulier, la privatisation des postes européennes
signifie très concrètement pour moi une forte hausse des
prix et une forte baisse du service. Cette année, 50% de mes
colis non assurés ont été perdus! La pression pour
que je choisisse des solutions assurées est donc forte! Il y a
maintenant tellement d'intermediaires, de filiales et de transporteurs
qui se refilent le colis entre 2 bureaux de poste européens que
les réclamations n'aboutissent jamais.
Les livreurs ne sont plus des fonctionnaires assermentés mais des
vacataires quasi-analphabètes (cf les bordereaux illisibles) qui
de plus n'ont pas le droit d'avoir la clef PTT-digicode pour
accéder aux immeubles. Comme ils sont visiblement
débordés (on les voit livrer en courant), je ne sais pas
trop ce qui les empêche de livrer chez un copain en une seule fois
tous les colis sans code-barre.
J'ai cru comprendre que la concurrence postale fait que les postes ne
s'interessent plus qu'à la clientèle juteuse des
entreprises.
|
rascal
16/10/2007
09:30 |
re : Comment privatiser les services publics |
le bon temps ou l'on ne pouvait pas envoyer par la poste un colis de
plus de 5 kilogs et de plus de 90 cm mémoire courte encore
eh le CA n'a plus que des representations sporadiques dans les village
quand il n'a carrement pas deserté les lieux...
tout se paie, la facture est la.
|
I Mean
23/10/2007
06:28 |
re : Comment privatiser les services publics |
Moi je pense qu'il faut supprimer tout ça et coller tout le monde
à la moitié du smic, en attendant de s'en
débarasser pour de bon. Comme ça on sera enfin entre nous,
nous les riches...
Et au moins on s'enrichira... Pas vrai, rascal ?
|
Wadayamine
23/10/2007
18:01 |
re : Comment privatiser les services publics |
Vous ne parlez que suppression mais c'est vous qu'il faudrait
supprimé vous et les suppots des multinationales alors que le
seul modèle économique viable c'est un pays reposant sur
le service public seule solution capable de fournir du travail à
tous les fonctionnaires seule façon de vivre dignement comme
chacun sait.
|
Nazdeb
20/12/2007
11:30 |
re : Comment privatiser les services publics |
Augmentation des tarifs GDF à venir, alors que les
bénéfices ne cessent de croître...
Je confirme ce que pense, tenez, Michel Rocard himself, s'exprimant il y
a quelques jours dans le Nouvel Obs (d'ailleurs où l'ai-je
classé cet article) : le problème ou disons plutôt
la chienlit de notre époque, c'est l'actionnariat ; c'est lui qui
bouffe tout, détruit tout, appauvrit tout...
Ah sacrée bande d'espèces de (---) !
-------------------------------
http://olivierbonnet.canalblog.com/archives/2007/12/19/72833
45.html
19 décembre 2007
Pourquoi la hausse du gaz est scandaleuse
Passée presque inaperçue hier, la confirmation de la
prochaine augmentation du gaz est tombée de la bouche de la
ministre de l'Economie. Sans susciter beaucoup de commentaires. Il faut
pourtant rappeler que le PDG de GDF avait promis la stabilité des
tarifs jusqu'en 2010, que son entreprise bat chaque année son
niveau record de bénéfices, mais que ses actionnaires
exigent des dividendes toujours plus élevés. Au moment
où le gouvernement prétend se démener pour lutter
contre la baisse du pouvoir d'achat, il donne son aval à une
nouvelle ponction sur les revenus, sur un poste budgétaire vital.
Les ménages modestes qui, déjà, ne s'en sortent
plus, seront les premières victimes. Mais les actionnaires du
futur GDF-Suez feront bombance.
Deux simples mots : service public. L'idée que certains biens ou
prestations ne sont pas des marchandises comme les autres, qu'ils sont
indispensables à une existence décente et que le
rôle de l'Etat, dans un pays riche, est de s'assurer que ses
ressortissants n'en soient pas privés : que chacun dispose d'un
minimum, puisse par exemple se nourrir, se soigner s'il est malade,
avoir un toit au-dessus de la tête, la possibilité de se
chauffer... Une élémentaire solidarité nationale
commande que ce type de besoins de base ne soit pas exploité pour
que des actionnaires privés touchent de juteux dividendes.
Quand de plus en plus de Français tirent chaque mois le diable
par la queue, n'y arrivent plus, décrochent peu à peu,
plongent dans la spirale de l'endettement, ne peuvent pas se loger
décemment, le pouvoir est impuissant à cacher que les
inégalités se creusent et que, hormis la minorité
qu'il chouchoute - qu'il a fallu protéger d'un bouclier fiscal -,
la plupart de nos concitoyens vit de plus en plus difficilement. La
pathétique réponse sarkoziste réside dans
l'exhortation à toujours plus de labeur. Il faut travailler plus,
sacrifier repos et vie personnelle, partir plus tôt, rentrer plus
tard, abandonner le dimanche chômé qui permet de passer un
peu de temps en famille, d'accompagner les petits faire du sport,
bientôt renoncer aux vacances... Et l'on nous somme d'endurer
cette existence pendant toujours plus longtemps, avant d'avoir droit
à une retraite (de misère) : voilà le
progrès social vu par le Président ! Sans compter que le
"travailler plus pour gagner plus" et les mesures en passe
d'être votées à l'Assemblée nationale,
censées doper le pouvoir d'achat - se souvient-on que son
amélioration figurait déjà dans l'objectif de la
loi Lagarde de juillet et son paquet fiscal ? -, ne concernent bien
évidemment qu'une minorité de Français. Les
salariés à qui les employeurs accorderont des heures
supplémentaires, consentiront à verser des primes
défiscalisées, accepteront de racheter les RTT. Nombre de
ceux-là, étranglés financièrement, n'auront
d'autre choix que se résigner à l'allongement du temps de
travail, si bien que mettre en avant le volontariat, dans ce contexte
économique de bas salaires et de chute du pouvoir d'achat, est
une nouvelle imposture. Et tous les autres ? Ceux à qui on ne
propose pas plus de 20 heures par semaine, les temps partiels subis, les
précaires, les chômeurs, les retraités, comment
vont-ils faire pour travailler plus ? Eux sont juste condamnés
à se serrer toujours davantage la ceinture. Et ils paieront des
franchises médicales s'ils sont coupables d'être malades !
Et les anciens les plus modestes devront s'acquitter de la redevance
audiovisuelle - qu'ils s'estiment heureux qu'on leur fasse royalement
cadeau, juste pour cette année, de 50% de son montant ! Ce sont
toujours sur les mêmes que pèse encore l'augmentation
galopante des denrées alimentaires. C'est dans ce contexte
général que la ministre de l'Economie annonce qu'elle va
autoriser GDF à augmenter les tarifs du gaz.
Flash back. Nous sommes en mars 2006 et Gaz de France annonce un
bénéfice record de 1,743 milliards d'euros, en hausse de
29%. Son PDG, Jean-François Cirelli, observe qu'il s'agit
"du bénéfice le plus élevé de son
histoire". "Nos perspectives de croissance sont
favorables" ajoute-t-il. Et le groupe de claironner qu'il vise pour
2006 un bénéfice net supérieur à 2 milliards
d'euros et qu'il va verser à ses actionnaires un dividende en
hausse de 48% pour 2005, qui "progresse au-delà" de
l'objectif fixé par le groupe lors de l'ouverture du capital, se
félicite Cirelli. Formidable donc ? Eh bien non, ce n'est pas
assez : il réclame à cor et à cris une augmentation
des tarifs du gaz. La précédente remonte à
novembre, de 3,8%. Après celle de juillet, de 4%. Avec la
régularité d'un métronome, le prix grimpe tous les
5 ou 6 mois : Thierry Breton, alors ministre UMP de l'Economie, accorde
une nouvelle augmentation de 5,8%, qui entre en vigueur le 1er mai
dernier. On apprend au même moment qu'il donne également
son accord à l'augmentation du... salaire du PDG, de 1,8% -
Cirelli émarge désormais à 309 981 euros bruts
annuels -, assortie pour la première fois d'un bonus sur
résultats (plafonné à 40% du fixe). «70% de
cette prime sont versés sur des critères purement
financiers. En gros, si l'objectif de 2 milliards de résultat net
fixé pour 2006 est dépassé, Cirelli touche sa
prime. Or, les seules variables d'ajustement pour le
bénéfice, c'est la hausse des tarifs et celle de la
productivité», explique alors un responsable de la CGT dans
Libération. Pour gagner (encore) plus, le PDG de Gaz de France
n'a donc pas le choix : il doit augmenter la rémunération
des actionnaires. Alors il tond la laine sur le dos des 11 millions de
particuliers abonnés au gaz. Lors de l'augmentation de mai
dernier, il avait pourtant juré qu'il ne s'en produirait plus
jusqu'en 2010 ! Il ne fallait pas le croire. Dans le contexte de la
fusion annoncée avec Suez, sur le point d'aboutir, alors qu'on
promet aux actionnaires une "politique dynamique de distribution de
dividende" (+50% en 3 ans), il faut prendre l'argent là
où il est : dans les poches des usagers ! Alors Christine
Lagarde, ardente défenseure du pouvoir d'achat, a donné
son feu vert à une nouvelle augmentation. De moins de 6%, c'est
tout ce qu'on sait pour l'instant. La nouvelle est passée
discrètement hier, parmi les brèves, sans que les
médias ne questionnent la légitimité de
l'opération, ni ne rappellent les chiffres : les
bénéfices de GDF sont passés de 1,15 milliards
d'euros en 2004, à 1,75 milliards en 2005, puis à 2,6
milliards en 2006 et, au premier semestre 2007, GDF a déjà
réalisé un bénéfice de 1,51 milliards
d'euros. Pendant ce temps-là, si l'on ajoute la hausse
vertigineuse du prix du fioul, la voie est ouverte pour que, dans un
pays qui comptait en 2005 11% de pauvres (vivant avec moins de 800 euros
par mois), selon la statistique de l'INSEE publiée en juillet
dernier, les gens meurent désormais de froid dans leurs maisons,
faute de pouvoir payer une énergie de plus en plus chère.
Mais pour les actionnaires du futur GDF-Suez, tout va bien.
Archives Plume de presse : Le PDG de Gaz de France se moque du monde (16
mars 2006), L'injustice sociale sent le gaz (22 mars 2006), Hausse des
tarifs du gaz... et du salaire du PDG ! (4 avril 2006) et GDF-Suez :
Sarkozy renie sa promesse (4 septembre 2007).
Posté par Olivier Bonnet à 08:13
-------------------------------

|
Unpassant
20/12/2007
16:49 |
trop bien Doc Korz |

Comme quoi il y a D.K. et D.K. et D.K.
|
Henry Faÿ
20/12/2007
17:37 |
tout sauf défenseure |
ardente défenderesse
|
Passant
20/12/2007
19:38 |
c'est où above? |
Il faut avoir lu la logorrhée ci-dessus pour dénicher
cette horreur.
|
Nazdeb
21/12/2007
11:00 |
re : Comment privatiser les services publics |
Z'avez raison, c'est de la logorrhée, copieusement fournie en
chiffres et faits, admettez tout de même.
Mais j'aurais dû carrément mettre du Rocard...
Z'en voulez ?
Allez, hop. Bonne lecture.
--------------------
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2249/articles/a36
2300-.html
Michel Rocard : La crise mondiale est pour demain
15 décembre 2007
La financiarisation, la prise du pouvoir sur l’activité
économique par l’actionnaire ont entrainé une diminution
des revenus du travail, un chômage et une précarisation
généralisés qui remettent en cause
l’équilibre du système en étranglant la demande, et
en privilégiant la spéculation à court terme sur
l’investissement productif. Jusqu’à présent, ce
déséquilibre structurel a été
compensé par un recours au crédit de plus en plus massif
par les états et les ménages . Mais tout le monde sait que
cette pyramide de dettes ne sera jamais remboursée. L’heure -
douloureuse - de régler les comptes a-t-elle sonné ?
Michel rocard répond aux questions de Jean-Gabriel Fredet et
François Armanet pour Le Nouvel Observateur, 13 décembre
2007
Avec les excès de la « financiarisation » de
l’économie, on entend souvent dire que nous sommes à la
veille d’une crise mondiale de l’ampleur de celle de 1929. Qu’en
pensez-vous ?
Nous sommes dans une situation étrange : les signes
avant-coureurs d’une crise mettant en cause l’équilibre
général de l’économie s’amoncellent et pourtant les
« opérateurs » restent silencieux. Ils ne disent rien
alors que pour la première fois, depuis deux cents ans, le
capitalisme est combattu non par ses vaincus, ses pauvres ou par les
intellectuels, porte-parole des vaincus, comme Marx ou Engels, mais par
des économistes objectifs.
Aujourd’hui, la critique vient du coeur du système.
L’avant-dernier livre de Patrick Artus, un des économistes
français les plus respectés [1], était
intitulé : « Le capitalisme est en train de
s’autodétruire ». Son dernier livre porte un titre
prémonitoire : « les Incendiaires ». Les «
incendiaires » en question sont les banquiers centraux. Il doit
vraiment y avoir quelque chose de pourri dans notre système pour
que Joseph Stiglitz, prix Nobel américain d’économie, ose,
lui, titrer son dernier un ouvrage « Quand le capitalisme perd la
tête ».
Qu’est-ce qui vous rend si pessimiste ?
Pour illustrer mes propos, je partirai de l’évolution de la dette
des Etats-Unis (dette des ménages, des entreprises et de l’Etat)
sur une longue période. On voit clairement son envolée
depuis 1982 (présidence Reagan) jusqu’à 2005
(présidence George Bush), en dépit d’une certaine
stabilisation sous Clinton. Lors de la crise de 1929, l’endettement
américain - environ 130% du produit national - était
déjà « au coeur du système ».
Aujourd’hui il atteint plus de 230% ! Pour éviter la faillite, le
système financier américain doit emprunter 2 milliards de
dollars par jour !
Voilà ma première inquiétude. Vous me direz - et
c’est la deuxième bizarrerie de notre situation - que le
système financier s’est « atomisé » : si les
grandes banques mondiales par qui le scandale arrive sont quatre fois
plus grosses qu’en 1929, elles opèrent dans un marché 50
à 100 fois plus gros puisque les transactions quotidiennes se
comptent en dizaines de milliards de dollars. Cette dilution, cette
atomisation a amorti les crises qui ont réapparu depuis 1990.
Il faut rappeler que de 1945 à 1980 le monde n’a connu que des
faillites nationales, pas de crises mondiales. C’était un des
grands succès du capitalisme régulé. Le
problème - et revoilà mes inquiétudes -, c’est que
depuis 1980 la sphère financière a pris une importance
colossale. Du coup, nous sommes confrontés à des crises
financières de grande ampleur récurrentes : crises
latino-américaines dans les années 1980 qui ont
affecté tout le continent américain ; crise asiatique dans
les années 1990 qui a fait des dégâts énormes
même si elle est restée circonscrite à une douzaine
de pays, crise du système monétaire européen en
1992, éclatement de la bulle de l’e-économie en 2000.
Les centaines de milliards de dollars carbonisés par
l’effondrement des valeurs boursières à l’occasion de
cette dernière secousse sont comparables aux pertes
enregistrées lors de la crise de 1929. Les chocs sont moins
instantanés, moins brutaux, moins impressionnants peut-être
aussi, mais ils sont quand même terrifiants, même si
l’atomisation des marchés les a rendus moins soudainement
brutaux.
Regardons maintenant les choses de plus près en commençant
par la dette. La dette américaine hors banques vient d’atteindre
39 000 milliards de dollars. Il est évident qu’elle ne sera
jamais remboursée. Nous sommes dans une logique qui ne laisse
espérer aucun retournement de tendance. Le problème est
donc celui de la « soutenabilité » de cette dette
grossie chaque jour de ses intérêts composés.
Jusqu’ici, des taux d’intérêt historiquement bas
permettaient d’emprunter et de l’honorer.
Avec la hausse du prix du pétrole qui hésite cette semaine
à passer la barre des 100 dollars le baril et l’envolée
des prix des produits agricoles, dopés par l’augmentation de la
demande alimentaire de l’Inde et de la Chine, cette possibilité
est en train de disparaître. Je m’explique : pour contrer le
retour de l’inflation, les banques centrales sont obligées de
relever leur taux d’intérêt. C’est le devoir de Jean-Claude
Trichet, président de la Banque centrale européenne, et
certaines institutions comme la Banque d’Angleterre n’hésitent
pas à augmenter franchement leur prix de l’argent. L’atomisation
du marché nous a jusqu’ici préservés d’une crise
générale, mais les miracles n’ont qu’un temps.
Comment en est-on arrivé à cette dette colossale alors
qu’il y a tant d’argent disponible ?
Ce passage d’un équilibre à un déséquilibre
massif, généralisé, tient au changement de la
répartition du produit national brut, entre les « salaires
» (salaires et revenus de protection versés par la
Sécurité sociale) et les « profits »
(bénéfices industriels, honoraires des professions
libérales, rémunérations « directes »
sur le marché).
Ce mouvement est très sensible en France mais on l’observe aussi
aux Etats-Unis et dans l’ensemble des pays européens, y compris
les pays de l’Est rejoints à toute allure par le capitalisme. En
gros, les salaires sont passés de 71% du PIB en 1981 à 60%
en 2005. Près de 11 points de chute ! Aujourd’hui, en France, si
le produit intérieur brut avait conservé le même
partage qu’en 1981, les ménages auraient dépensé en
salaires et revenus de Sécurité sociale 130 milliards
d’euros de plus. Affectés à la consommation, ces 130
milliards auraient donné au moins 1 point de plus de croissance
chaque année. Et nous aurions eu en France un demi-million de
chômeurs de moins.
Que s’est-il passé ? Comment s’explique ce nouveau «
partage » entre salaires et profits ?
Pour comprendre la perversité de ce nouveau partage qui ne permet
plus à la consommation de soutenir la croissance et, à
terme, de créer les moyens de rembourser la dette, il faut se
rappeler comment a fonctionné le capitalisme triomphant de 1945
à 1975. Pendant trente ans, l’économie occidentale a
progressé au rythme de 5% l’an, sans jamais de crises
financières et avec un chômage quasi nul (2% de la
population active, c’est à peu près le chômage
frictionnel dû à la mobilité professionnelle) . Les
raisons de cette embellie ?
Précisément les mauvais souvenirs de la grande crise de
1929, de son cortège de malheurs avec la prolétarisation
des classes moyennes et finalement la guerre. Pour que pareille
catastrophe ne se reproduise pas, le monde occidental avait mis en place
trois types de correction dont chacune a pour père une
personnalité exceptionnelle : lord Beveridge, lord Maynard Keynes
et Henry Ford.
Beveridge, c’est l’Anglais inventeur de la Sécurité
sociale, qui a théorisé le fait qu’en faisant beaucoup de
protection sociale non seulement on humanisait le système, mais
on le stabilisait en empêchant la demande - maintenue au moins au
tiers du pouvoir d’achat - de tomber.
Deuxième régulateur, Keynes. Message aux dirigeants
politiques : au lieu d’utiliser la politique monétaire et
budgétaire comme des instruments de régulation nationale,
utilisez-la pour accélérer ou
décélérer les secousses venant de
l’extérieur, du marché mondial, là où les
pays démocratiques s’affrontent. Cela a marché. Nous en
avons eu la preuve expérimentale pendant trente ans.
Le troisième régulateur, Henry Ford, est américain.
Cet industriel disait : « Je paie mes ouvriers pour qu’ils
m’achètent mes voitures. » Avec le New Deal, les grands
travaux de Roosevelt, cette politique de hauts salaires et de
fidélisation des salariés qualifiés a permis
à l’économie américaine de repartir très
vite après la crise de 1929. La France a utilisé le Plan,
ce forum entre syndicats, patrons et Etat, réunis pour
préserver un haut niveau de demande (donc de salaires) afin de
permettre des anticipations de consommation forte.
Bref, nous nous sommes tous peu ou prou lancés dans des
politiques de reconnaissance du monde salarial et de légitimation
d’une politique de hautes rémunérations parce que,
concernant la moitié basse de la population, ces dernières
sont presque entièrement affectées à la
consommation. Et fondent la croissance. Résultat : une croissance
soutenue, mais avec un grand absent, l’actionnaire - une des composantes
du « profit », selon la comptabilité nationale. Il a
été le grand oublié en termes de distribution de
dividendes pendant toute cette période.
Tout a changé dans les années 1990 avec l’apparition des
fonds et d’abord des fonds de pension. L’actionnaire s’est
organisé et, s’agissant de sa retraite, a exigé un retour
sur investissement de plus en plus élevé. Corollaire : une
pression de plus en plus forte sur les salaires qui ont cessé de
progresser au rythme d’antan avant de décroître en valeur
absolue. Les fonds d’investissement - moins du quart des fonds de
pension mais plus agressifs - ont intensifié la tendance. Et les
fonds d’arbitrage ou hedge funds jouent le même jeu. Pour garantir
aux actionnaires une rémunération élevée,
tous n’hésitent pas à démanteler leur proie et
à vendre par appartements.
Au grand dam des salariés réduits à la dimension de
variable d’ajustement. Le nouveau système - tout pour les
actionnaires, le moins possible pour les salariés - est devenu
presque caricatural avec les hedge funds, ces fonds spéculatifs.
L’ensemble de ces fonds sont présents désormais dans
toutes les entreprises du monde occidental de plus de 2 000
salariés. Leur pression s’est d’abord exercée sur les PDG
qui ne distribuaient pas assez de dividendes : ils ont très vite
valsé.
Elle s’est traduite ensuite par l’externalisation des toutes les
fonctions - entretien, maintenance, services sociaux internes -, dont
les salariés étaient indexés sur les personnels
qualifiés qui faisaient le renom de l’entreprise. Tous ces
gens-là ont été chassés et recasés
dans des PME désyndicalisées, soumises à des
contraintes salariales énormes parce que les fabricants, les
donneurs d’ordre, peuvent changer de sous-traitants sans préavis.
C’est comme ça que s’est instituée la précarisation
du marché du travail (16% des salariés français
aujourd’hui) avec, comme conséquence de cette réduction
« contrainte » des heures travaillées, un gel ou un
recul des salaires, l’apparition de working poors et de vrais pauvres
sans travail.
Avec une pauvreté de masse évaluée à 10
millions de personnes en Grande-Bretagne et entre 5 et 6 millions en
France, la part des salaires dans le PIB a évidemment
reculé par rapport au « profit » réinvesti de
manière spéculative. D’où, faute d’une demande
suffisante, une croissance anémiée, incapable de contenir
l’hémorragie des déficits et une dette de plus en plus
difficile à rembourser.
Recherche d’une plus-value instantanée, spéculation
effrénée et, comme l’indique la crise des crédits
hypothécaires aux Etats-Unis, « titrisation » des
créances et création de produits de plus en plus
sophistiqués plongeant les marchés dans l’opacité :
tous les ingrédients d’une crise d’ampleur sont réunis.
Mais la donne aussi a changé : il y a la croissance
générée par les pays émergents qui relaie la
locomotive américaine défaillante. Il y a aussi
l’abondance de liquidités : pétrodollars et
excédents structurels chinois ou japonais.
Par rapport à l’économie physique réelle, ces
liquidités sont en effet sans précédent. Mais elles
ne s’orientent pas vers l’investissement long. Elles
préfèrent les investissements financiers
spéculatifs. Tous les banquiers vous le diront, malgré
leur affinement, les politiques économiques ne peuvent rien sur
l’usage et l’évolution de ces liquidités. Ce
dysfonctionnement, culturel dans sa nature, structurel dans son
résultat, est terrible. Personne ne sait comment ça peut
finir, et j’ai la conviction que ça va bientôt exploser.
J’en tire deux conclusions.
La première, c’est qu’il faut des réponses mondiales, en
réformant les institutions créées il y a plus d’un
demi-siècle à Bretton-Woods. Nouveau directeur du Fonds
monétaire international, notre ami Strauss-Kahn est aux commandes
d’un « machin » qui n’est pas opérationnel car il n’a
pas les moyens de contrer ces nouvelles crises. Mais il a l’information
: c’est l’endroit central pour émettre un diagnostic et faire des
propositions.
Ma deuxième conclusion : si en France le PS était capable
de comprendre ce qui se passe, de faire la liaison entre la situation
nationale et l’international et pouvait expliquer les raisons de la
montée du travail précaire chez nous, il donnerait enfin
l’impression de répondre à la situation. Il y aura une
prime au premier qui saura expliquer. C’est le capitalisme dans sa forme
mondialisée et financiarisée non le marché dont je
suis partisan - qui est en cause aujourd’hui. Faire ce type d’analyse,
lui donner une réponse nous réconcilierait avec les
gauchistes !
Enfin il est essentiel que de nouvelles règles aident à
préparer une place commerciale intelligemment
négociée à ces nouveaux partenaires énormes
que sont la Chine et l’Inde.
Que peut-on faire ?
Il y a d’abord l’attaque éthique. Au centre de cette pression sur
les salaires, de cette voracité spéculative des hautes
classes moyennes et des classes riches, les gens fraudent de plus en
plus : délits sur les stock-options, délits
d’initié...
Il faut maintenir une pénalisation du droit des affaires. De la
même manière, il faut plafonner les revenus des grands
patrons. A l’époque de Henry Ford, ils étaient
payés 40 fois le salaire moyen, aujourd’hui, c’est 350 ou 400
fois ! (On peut considérer que ce superprélèvement
directorial est négligeable, il est cependant
particulièrement inélégant et nocif.) Puisqu’on
veut moins d’Etat, le capitalisme doit rester éthique.
Deuxième élément : réglementer les OPA au
niveau européen en énonçant des critères qui
empêcheront la destruction et la précarisation de la
population salariale du groupe ainsi constitué. Ensuite, il faut
que les accords sur le droit social passés dans le cadre de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) soient compatibles avec
les règles de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) qui fait
du libre-échange une religion. Aujourd’hui, les Etats peuvent
ignorer superbement ce qu’ils ont signé d’une main à l’OIT
quand ils négocient à l’OMC.
Je crois enfin à l’économie sociale. J’ai milité
depuis quarante ans pour lui donner son statut, son cadre. Je crois que
la clé du problème, c’est le changement du statut
juridique de l’entreprise. Au lieu d’appartenir à des apporteurs
extérieurs de capitaux, elle doit être faite de la
communauté des hommes et des femmes qui gagnent leur vie en
partageant un même projet économique.
Retour à l’autogestion ?
Je me garderais bien d’employer les mots qui fâchent. S’agissant
d’un projet mondial, je ne vois qu’une seule force capable de le mener
à bien : la social-démocratie internationale. Il va
falloir défendre tout ce qui produit contre tout ce qui
spécule. C’est ça, la nouvelle lutte des classes.
Ancien Premier ministre (1988-1991), Michel Rocard est depuis 1994
député au Parlement européen. Derniers ouvrages
parus : « Si la gauche savait » (Robert Laffont, 2005) et
« Peut-on réformer la France ? » (Autrement,
2006).
publication originale Nouvel Obs
[1] Voir l’entretien avec Patrick Artus le capitalisme est-il devenu fou
?
--------------------

|
Henry Faÿ
30/12/2007
15:30 |
la hausse du prix du gaz est-elle scandaleuse? |
<<19 décembre 2007
Pourquoi la hausse du gaz est scandaleuse
Passée presque inaperçue hier, la confirmation de la
prochaine augmentation du gaz est tombée de la bouche de la
ministre de l'Economie. Sans susciter beaucoup de commentaires. Il faut
pourtant rappeler que le PDG de GDF avait promis la stabilité des
tarifs jusqu'en 2010, que son entreprise bat chaque année son
niveau record de bénéfices, mais que ses actionnaires
exigent des dividendes toujours plus élevés. Au moment
où le gouvernement prétend se démener pour lutter
contre la baisse du pouvoir d'achat, il donne son aval à une
nouvelle ponction sur les revenus, sur un poste budgétaire vital.
Les ménages modestes qui, déjà, ne s'en sortent
plus, seront les premières victimes. Mais les actionnaires du
futur GDF-Suez feront bombance.
Deux simples mots : service public. L'idée que certains biens ou
prestations ne sont pas des marchandises comme les autres, qu'ils sont
indispensables à une existence décente et que le
rôle de l'Etat, dans un pays riche, est de s'assurer que ses
ressortissants n'en soient pas privés : que chacun dispose d'un
minimum, puisse par exemple se nourrir, se soigner s'il est malade,
avoir un toit au-dessus de la tête, la possibilité de se
chauffer... Une élémentaire solidarité nationale
commande que ce type de besoins de base ne soit pas exploité pour
que des actionnaires privés touchent de juteux dividendes.
Quand de plus en plus de Français tirent chaque mois le diable
par la queue, n'y arrivent plus, décrochent peu à peu,
plongent dans la spirale de l'endettement, ne peuvent pas se loger
décemment, le pouvoir est impuissant à cacher que les
inégalités se creusent et que, hormis la minorité
qu'il chouchoute - qu'il a fallu protéger d'un bouclier fiscal -,
la plupart de nos concitoyens vit de plus en plus difficilement. La
pathétique réponse sarkoziste réside dans
l'exhortation à toujours plus de labeur. Il faut travailler plus,
sacrifier repos et vie personnelle, partir plus tôt, rentrer plus
tard, abandonner le dimanche chômé qui permet de passer un
peu de temps en famille, d'accompagner les petits faire du sport,
bientôt renoncer aux vacances... Et l'on nous somme d'endurer
cette existence pendant toujours plus longtemps, avant d'avoir droit
à une retraite (de misère) : voilà le
progrès social vu par le Président ! Sans compter que le
"travailler plus pour gagner plus" et les mesures en passe
d'être votées à l'Assemblée nationale,
censées doper le pouvoir d'achat - se souvient-on que son
amélioration figurait déjà dans l'objectif de la
loi Lagarde de juillet et son paquet fiscal ? -, ne concernent bien
évidemment qu'une minorité de Français. Les
salariés à qui les employeurs accorderont des heures
supplémentaires, consentiront à verser des primes
défiscalisées, accepteront de racheter les RTT. Nombre de
ceux-là, étranglés financièrement, n'auront
d'autre choix que se résigner à l'allongement du temps de
travail, si bien que mettre en avant le volontariat, dans ce contexte
économique de bas salaires et de chute du pouvoir d'achat, est
une nouvelle imposture. Et tous les autres ? Ceux à qui on ne
propose pas plus de 20 heures par semaine, les temps partiels subis, les
précaires, les chômeurs, les retraités, comment
vont-ils faire pour travailler plus ? Eux sont juste condamnés
à se serrer toujours davantage la ceinture. Et ils paieront des
franchises médicales s'ils sont coupables d'être malades !
Et les anciens les plus modestes devront s'acquitter de la redevance
audiovisuelle - qu'ils s'estiment heureux qu'on leur fasse royalement
cadeau, juste pour cette année, de 50% de son montant ! Ce sont
toujours sur les mêmes que pèse encore l'augmentation
galopante des denrées alimentaires. C'est dans ce contexte
général que la ministre de l'Economie annonce qu'elle va
autoriser GDF à augmenter les tarifs du gaz.
Flash back. Nous sommes en mars 2006 et Gaz de France annonce un
bénéfice record de 1,743 milliards d'euros, en hausse de
29%. Son PDG, Jean-François Cirelli, observe qu'il s'agit
"du bénéfice le plus élevé de son
histoire". "Nos perspectives de croissance sont
favorables" ajoute-t-il. Et le groupe de claironner qu'il vise pour
2006 un bénéfice net supérieur à 2 milliards
d'euros et qu'il va verser à ses actionnaires un dividende en
hausse de 48% pour 2005, qui "progresse au-delà" de
l'objectif fixé par le groupe lors de l'ouverture du capital, se
félicite Cirelli. Formidable donc ? Eh bien non, ce n'est pas
assez : il réclame à cor et à cris une augmentation
des tarifs du gaz. La précédente remonte à
novembre, de 3,8%. Après celle de juillet, de 4%. Avec la
régularité d'un métronome, le prix grimpe tous les
5 ou 6 mois : Thierry Breton, alors ministre UMP de l'Economie, accorde
une nouvelle augmentation de 5,8%, qui entre en vigueur le 1er mai
dernier. On apprend au même moment qu'il donne également
son accord à l'augmentation du... salaire du PDG, de 1,8% -
Cirelli émarge désormais à 309 981 euros bruts
annuels -, assortie pour la première fois d'un bonus sur
résultats (plafonné à 40% du fixe). «70% de
cette prime sont versés sur des critères purement
financiers. En gros, si l'objectif de 2 milliards de résultat net
fixé pour 2006 est dépassé, Cirelli touche sa
prime. Or, les seules variables d'ajustement pour le
bénéfice, c'est la hausse des tarifs et celle de la
productivité», explique alors un responsable de la CGT dans
Libération. Pour gagner (encore) plus, le PDG de Gaz de France
n'a donc pas le choix : il doit augmenter la rémunération
des actionnaires. Alors il tond la laine sur le dos des 11 millions de
particuliers abonnés au gaz. Lors de l'augmentation de mai
dernier, il avait pourtant juré qu'il ne s'en produirait plus
jusqu'en 2010 ! Il ne fallait pas le croire. Dans le contexte de la
fusion annoncée avec Suez, sur le point d'aboutir, alors qu'on
promet aux actionnaires une "politique dynamique de distribution de
dividende" (+50% en 3 ans), il faut prendre l'argent là
où il est : dans les poches des usagers ! Alors Christine
Lagarde, ardente défenseure du pouvoir d'achat, a donné
son feu vert à une nouvelle augmentation. De moins de 6%, c'est
tout ce qu'on sait pour l'instant. La nouvelle est passée
discrètement hier, parmi les brèves, sans que les
médias ne questionnent la légitimité de
l'opération, ni ne rappellent les chiffres : les
bénéfices de GDF sont passés de 1,15 milliards
d'euros en 2004, à 1,75 milliards en 2005, puis à 2,6
milliards en 2006 et, au premier semestre 2007, GDF a déjà
réalisé un bénéfice de 1,51 milliards
d'euros. Pendant ce temps-là, si l'on ajoute la hausse
vertigineuse du prix du fioul, la voie est ouverte pour que, dans un
pays qui comptait en 2005 11% de pauvres (vivant avec moins de 800 euros
par mois), selon la statistique de l'INSEE publiée en juillet
dernier, les gens meurent désormais de froid dans leurs maisons,
faute de pouvoir payer une énergie de plus en plus chère.
Mais pour les actionnaires du futur GDF-Suez, tout va bien.
Archives Plume de presse : Le PDG de Gaz de France se moque du monde (16
mars 2006), L'injustice sociale sent le gaz (22 mars 2006), Hausse des
tarifs du gaz... et du salaire du PDG ! (4 avril 2006) et GDF-Suez :
Sarkozy renie sa promesse (4 septembre 2007).>>
Donc la hausse du gaz serait scandaleuse, au motif que Gaz de France
fait des profits. Depuis longtemps, lecteur assidu de publications
d’inspiration écologique, par exemple de ce qu’écrit
Jean-Marc Jancovici, le meilleur auteur en cette matière, je suis
convaincu que de toutes façons, le coût de l’énergie
augmentera et qu’il est bon qu’il augmente, ne serait-ce que pour
favoriser le passage à des énergies renouvelables et
apprendre à consommer moins d’énergie. L’idée d’une
hausse du prix du gaz ne me choque donc pas. Par ailleurs, l’idée
que les profits viennent amputer le pouvoir d’achat des consommateurs
relève d’une arriération du raisonnement
économique. Le texte donne abondamment dans le pathos mais
l’assistance sociale et l’approvisionnement en énergie
obéissent à des logiques différentes, ils doivent
relever de domaines séparés. Dans tout ce beau
raisonnement, il manque l’élément essentiel, c'est le
montant des investissements nécessaires pour moderniser un
secteur en pleine mutation technologique. Imaginons que ces
investissements ne soient pas faits, c'est alors qu'il y aurait (i) des
pénuries (ii) une hausse du prix du gaz. Tiens, j’ai un exemple
presque sous les yeux, je suis dans un pays qui a un des plus gros
équipements hydroélectriques du Monde, le barrage Inga,
sur le fleuve Congo et où la capitale pourtant proche subit des
coupures d’électricité incessantes, faute
d’investissements effectués à temps.
La préoccupation légitime de Madame Lagarde,
défenderesse du pouvoir d’achat mais surtout soucieuse, je
l’espère, de l’intérêt public à long terme
qui s’identifie au développement du secteur de l’énergie,
c'est d'assurer les investissements du secteur. Comment? Elle aurait,
théoriquement le choix entre un appel au financement public ou
au financement privé.
Le financement public représente une affectation des montants
que l’Etat a à sa disposition, que l’Etat a bien du mal à
collecter et qui viendrait en concurrence avec toutes les autres
affectations, ô combien nécessaires. Les
inconvénients sont nombreux mais c’est une
possibilité.
Le financement privé a l’avantage de ne pas peser sur les
finances publiques et si tel est le choix, il faut effectivement que le
secteur soit bénéficiaire et il ne peut l’être que
si l’on consent à des hausses de prix. Ne pas les accorder serait
compromettre l’avenir. Ces hausses de prix ne sont donc pas
illégitimes et ne doivent pas être présentées
comme un complot contre les plus pauvres.
Il est aussi possible que le financement soit public mais que l’Etat
actionnaire soit soucieux de « reprendre ses billes »,
c’est-à-dire en fait de se comporter comme un actionnaire
privé, cela s’est beaucoup vu, on n’est alors pas dans un cas de
figure très différents du financement privé, et les
hausses de prix ne seraient pas évitées.
Je crois que ce qui rend le financement privé indispensable,
c’est que c’est le seul qui rende possible des opérations de
coopération internationales de grande échelle qui
permettent, je le suppose de rentabiliser des investissements
très importants, je suis bien conscient que j’emploie un langage
qu’un certain nombre de participants au forum refuseront d’entendre.

|
guydufau
30/12/2007
17:32 |
re : Comment privatiser les services publics |
"Le financement privé a l’avantage de ne pas peser sur les
finances publiques et si tel est le choix, il faut effectivement que le
secteur soit bénéficiaire et il ne peut l’être que
si l’on consent à des hausses de prix. Ne pas les accorder serait
compromettre l’avenir. Ces hausses de prix ne sont donc pas
illégitimes et ne doivent pas être présentées
comme un complot contre les plus pauvres."
Signé par Henry
C'est bizarre, car il vient de transmettre à notre connaissance
-et peut-être à la sienne?- ceci :
"Dans le contexte de la fusion annoncée avec Suez, sur le
point d'aboutir, alors qu'on promet aux actionnaires une "politique
dynamique de distribution de dividende" (+50% en 3 ans)".
Il est donc clair que les augmentations du prix du gaz n'ont pas, pour
seul but, des investissements, mais aussi d'engraisser les
actionnaires. Et ce n'est qu'un début, le capitalisme
d'aujourd'hui a pour objectif de dégager des
bénéfices allant jusqu'à 15% du chiffre
d'affaire.
"Il est aussi possible que le financement soit public mais que
l’Etat actionnaire soit soucieux de « reprendre ses billes
», c’est-à-dire en fait de se comporter comme un
actionnaire privé, cela s’est beaucoup vu, on n’est alors pas
dans un cas de figure très différents du financement
privé, et les hausses de prix ne seraient pas
évitées."
signe encore Henry, qui s'avère un drôle de citoyen. N'y
a-t-il aucune différence entre des actionnaires privés qui
touchent leurs dividendes et la collectivité qui
bénéficie des bénéfices d'une entreprise
publique?
"Je crois que ce qui rend le financement privé
indispensable, c’est que c’est le seul qui rende possible des
opérations de coopération internationales de grande
échelle qui permettent, je le suppose de rentabiliser des
investissements très importants, je suis bien conscient que
j’emploie un langage qu’un certain nombre de participants au forum
refuseront d’entendre."
conclue Henry. Evidemment il y a "un certain nombre de participants
à ce forum qui "refuseront d'entendre". Pour la bonne
raison qu'il y a des domaines qui doivent être hors marché
et l'énergie en fait partie. De plus ils sont favorable au
service public.
|
OH !
31/12/2007
01:56 |
pour Henry Faÿ |
Salut.
Ton message du 30/12/2007 à 15h30 est superbe.
Le seul problème est que tu confonds théorie et
réalité.
Mais j'imagine que tu n'as pas besoin de penser pour vivre.
Bonne chance dans la vie, et bonne année 2008.
|
Henry Faÿ
31/12/2007
09:52 |
merci |
<<Salut.
Ton message du 30/12/2007 à 15h30 est superbe.>>
Merci
<<Le seul problème est que tu confonds théorie et
réalité.>>
Il me semble que c'est le contraire. J'ai non pas écrit mais
suggéré que le financement public aurait des avantages
certains mais que les besoins de financement sont si importants qu'il
faut bien recourir au financement privé, c'est tenir compte de la
réalité, n'est-il pas?
<<Mais j'imagine que tu n'as pas besoin de penser pour
vivre.>>
Mais si mais si et pour m'aider, j'ai pris avec moi les trois tomes de
l'histoire de la philosophie de l'encyclopédie de la
Pléiade, j'en suis à un article particulièrement
difficile mais ô combien passionnant de Madeleine Biardeau sur la
philosophie indienne ancienne.
<<Bonne chance dans la vie, et bonne année 2008.>>
Merci surtout que l'année 2008 risque de ne pas être facile
pour moi.
|
Henry Faÿ
31/12/2007
09:55 |
les imprévus d'internet |
Le message est parti avant que je lui indique de partir.
Je complète:
à toi aussi
|
| Retour à la liste des messages |
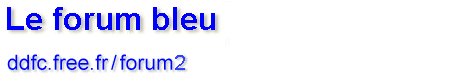






































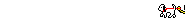








 smiley
smiley