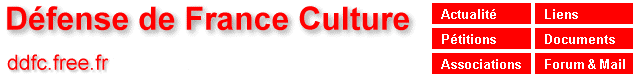|
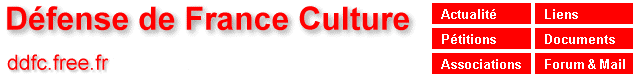
La casse
de France Culture, une faute politique du PS
En écoutant
la grille des programmes de septembre 2006, on se dit que le nouveau directeur
de France Culture, ancien conseiller de Lionel Jospin, n'est pas là
pour redresser la chaîne après l'ouragan Adler (1999-2005),
mais plutôt pour rendre les ruines de la station présentables
à l'auditeur de passage. De ce fait il devient important de replacer
dans son contexte politique l'histoire de la destruction d'une université
populaire radiophonique unique au monde
On peut considérer que le destin de France Culture bascule en novembre
1995, lorsque sous le gouvernement Juppé, Michel Boyon est nommé
pour 3 ans à la tête de Radio France. Cet énarque,
qui dirige actuellement Réseau Ferré de France, n'a pas d'affinité
avec la radio, encore moins avec France Culture, une station d'exception
qu'il trouve "ringarde". Dans une ambiance tendue, il lance une
mission de réflexion sur cette chaîne atypique jugée
coûteuse, élitiste et indocile, par le personnel politique,
et ce malgré ses 3,6 millions d'auditeurs satisfaits [1]. Par parenthèse,
remarquons que l'anti-élitisme est une idéologie à
géométrie variable : avec un budget bien moindre, les
500.000 auditeurs quotidiens de France Culture en 1997 sont plus critiqués
que les 2000 spectateurs de l'Opéra de Paris. Sans même attendre
les conclusions du rapport Ténèze (janvier-avril 1997), qui
préconise des économies et une rationalisation des programmes,
Michel Boyon nomme, le 26 mars 1997, Patrice Gélinet comme nouveau
directeur de France Culture. L'ancien directeur, Jean Marie Borzeix, doit
quitter son poste le 30 juin après 13 années de services,
alors que sa grille de prorammes est très appréciée
des auditeurs.
L'arrivée au pouvoir en juin 1997 du gouvernement Jospin, ne modifie
pas la situation, tant l'Etat culturel est devenu un point de convergence
des politiciens PS-UMP. Sympathisant de l'extrême droite dans sa
jeunesse [2], le nouveau directeur s'adjoint un homme de gauche, Antoine
Spire (producteur de Staccato), pour mener, en pleine cohabitation, la
réforme des programmes de France Culture. Cette modernisation à
visage jeuniste et consumériste de la station débute en octobre
1997 et ne va pas sans résistances internes, ni tensions. Dans ce
climat particulier, Michel Bydlowski, responsable de la célèbre
émission Panorama, choisit de se suicider le 21 février 1998
sur son lieu de travail, après une dernière émission.
Après ce traumatisme, le gouvernement Jospin et le CSA nomment Jean
Marie Cavada en remplacement de Michel Boyon en 1998 et Laure Adler en
remplacement de Patrice Gélinet début 1999. A partir de cette
date, France Culture est entre les mains de personnalités proches
du parti socialiste.
Le saccage d'une certaine idée de l'art radiophonique
Depuis 1999, la destruction de l'université populaire
radiophonique France Culture pour en faire une radio "comme les autres",
a été réalisée par différents moyens
:
¤ En confiant des tranches horaires du service public à des
médias privés (groupe Le Monde-Télérama, l'Express...)
ou à des représentants de médias privés (Figaro,
Inrocks...), ce qui a tué l'originalité et l'indépendance
éditoriale de la chaîne, tout en favorisant un certain unanimisme,
le silence des médias sur la casse de France Culture et le silence
de France Culture sur certains sujets. De même, la multiplication
des partenariats a muselé la critique indépendante et le
débat contradictoire à l'antenne..
¤ En traitant en priorité et jusqu'à l'absurde les
mêmes sujets que tous les autres médias ; en excluant peu
à peu les livres des petits éditeurs. Est-ce le rôle
du service public de relayer gratuitement les campagnes publicitaires des
géants de l'édition ? Jusqu'à 1997, France Culture
faisait le contraire et enchantait ses auditeurs par son audacieuse programmation
à contre-courant.
¤ En supprimant peu à peu le documentaire historique, musical,
scientifique, littéraire… Ce qui subsiste en 2006 et que la direction
appelle documentaire est essentiellement du reportage "tranche de
vie".
¤ En remplaçant les émissions soigneusement montées
et élaborées, qui ont fait la réputation de la chaîne,
par des émissions de bavardage promotionnel, des émissions
de bateleurs en public et une inflation de chroniques et débats.
Hélas, les émissions de bateleurs ne sont pas conçues
pour être intéressantes mais pour aller à la pêche
aux auditeurs dans des lieux publics.
¤ En réduisant ou même supprimant le recours aux producteurs
tournants, système original qui faisait qu'une émission donnée
était produite chaque semaine par un producteur différent
de façon à proposer des regards multiples et approfondis
(Les Chemins de la connaissance, Les chemins de la musique…),
¤ En organisant le remplacement des producteurs atypiques de France
Culture par des journalistes standardisés, des jeunes diplômés
inexpérimentés, des amis du Château ou des personnalités
TV, lesquelles coûtent cher en salaires et en assistants pour un
résultat médiocre.
¤ En propageant une vision idéologique de la culture centrée
sur l'actualité immédiate et le sociétal, dans laquelle
la transmission des connaissances et des savoirs n'a aucune importance,
ce qui rappelle certains errements pédagogiques des IUFM de l'ère
Jospin. A la place, l'antenne est envahie par des produits culturels à
consommer, de la morale humanitaire, des nouvelles de Boboland, de la repentance,
du jeunisme, des bavardages de comptoir, des bons sentiments, etc.
¤ En détruisant la spécificité du son France
Culture, en particulier par l'emploi d'un compresseur sur le signal d'antenne
[3] mais aussi par la mise en avant de voix non travaillées et négligées.
Plus généralement, la chaîne est envahie par des acteurs
de la société du spectacle, qui ne comprennent pas la subtilité
du langage radiophonique. Par ailleurs, la réception de France Culture
est perturbée depuis 5 ans à l'est de la capitale, ce qui
donne une idée de l'empressement du CSA à régler les
problèmes [4] .
Bien d'autres paramètres concourent à l'effondrement intellectuel
de la station, par exemple la relégation des dernières émissions
intelligentes aux heures de moindre écoute, le fameux prime time
étant envahi par des magazines calqués sur France Inter ou
Europe1.
France Culture : une vitrine du socialisme mondain
Côté coulisses, le paysage social et sociologique
est lui aussi édifiant, quoique moins connu du public [5]. A France
Culture, le partage des richesses est souvent évoqué à
l'antenne mais non pratiqué en interne. D'un côté on
trouve les stagiaires: indispensables mais non payés ; de l'autre
des people, dispensables et surpayés. Au milieu, des producteurs
stressés qui vivent dans la crainte permanente du licenciement.
Inauguré sous le gouvernement Jospin, le management brutal de cette
chaîne publique entre 1999 et 2005 a éclairé d'un jour
particulier, le fonctionnement des élites socialistes. "La
situation est d'autant plus tendue que, pour la première fois, on
licencie brutalement dans une entreprise traditionnellement feutrée
et courtoise qui n'a jamais connu de telles méthodes de management".
peut-on lire dans Le Monde du 7 novembre 1999 [6]. Question recrutement,
il est intéressant de constater qu'en pratique, le service public
France Culture a renvoyé des producteurs de la classe moyenne pour
embaucher prioritairement dans la haute bourgeoisie et les "fils et
filles de…". Alors que le chômage est le problème numéro
1 en France, des producteurs confirmés de la chaîne ont été
renvoyés tandis que des personnalités mondaines extérieures
"surbookées" venaient empocher un revenu de plus sur France
Culture. C'est ainsi que par exemple le directeur du Monde, la directrice
du Seuil Littérature, la directrice de Normale Sup, etc. ont leur
propre émission sur France Culture, dans trois domaines (respectivement,
la politique, le cinéma, l'éthique) que les anciens producteurs
de la chaîne traitaient de façon bien plus approfondie. Sans
compter que Le Monde, Le Seuil et Normale Sup sont des structures en crise
qui auraient bien besoin de directeurs à plein temps !
Pourquoi la casse de France Culture est-elle une faute politique
?
Sur un ensemble de 3.6 millions d'auditeurs, combien
d'électeurs ne pardonneront jamais au parti socialiste d'avoir cassé
une radio unique au monde ? Inversement, ccombien d'électeurs
vont-ils se soucier de remercier le parti socialiste pour la création
d'un robinet d'eau tiède culturelle ? Lorsqu'on additionne
la casse de France Culture avec d'autres casses de services publics dans
la même période, on ne s'étonnera pas trop qu'il ait
manqué 200.000 voix au candidat Jospin en 2002. Bref une faute politique
d'autant plus stupide qu'en cassant France Culture, les socialistes ont
réalisé un objectif de l'UMP. En juillet 2004, Mme Laure
Adler se vantait dans Le Monde d'avoir fait de France Culture une radio
"comme les autres". Un an plus tard, le président Jacques
Chirac lui remettait la Légion d'honneur.
France Culture apparaît comme une vitrine parmi d'autres de l'Etat
UMP et de son opposant officiel, le PS. Triste duo qui se partage les institutions
de la France et s'auto-amnistie de ses errements.
DDFC - Défense de France Culture
3 octobre 2006
Adresse de l'article : http://ddfc.free.fr/faute.htm
Forum : http://ddfc.free.fr/forum
[1] audience cumulée hebdomadaire. Source : interview de Jean
Marie Borzeix dans Le Débat n° 95
[2] Le Monde - 30 mars 1997 - 6 avril 1997
[3] voir http://ddfc.free.fr/comp.htm
[4] voir http://aafc.free.fr/reception.html
et http://www.ville-bagnolet.fr/index.php?pge=416
[5] signalons le Canard Enchaîné du 2 août 2006
[6] une fois la grève à Radio France terminée, Le
Monde cesse à partir de janvier 2000 d'émettre des critiques
sur le fonctionnement de France Culture
|